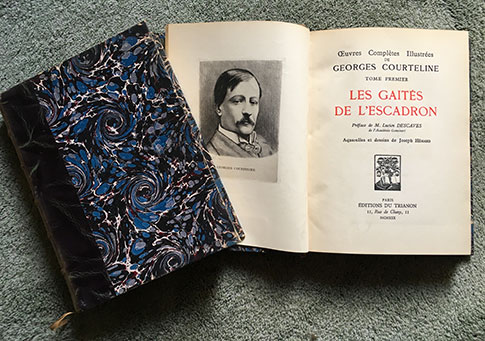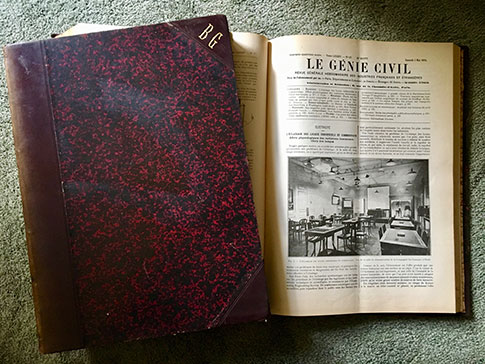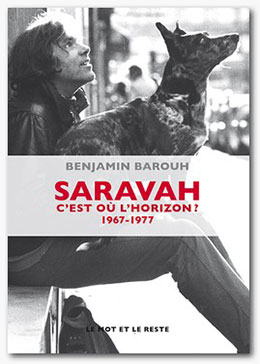Après les occasions manquées de Jean Morières, Didier Petit, Roger Turner, Pascal Contet, Philippe Deschepper, François Cotinaud, Pascale Labbé, Carlos Zingaro, Veryan Weston, Stéphane Payen, Fred Van Hove et moi-même, terminons ce cycle avec celles de Guy Le Querrec, Adam Linz et Bernard Vitet
Après les occasions manquées de Jean Morières, Didier Petit, Roger Turner, Pascal Contet, Philippe Deschepper, François Cotinaud, Pascale Labbé, Carlos Zingaro, Veryan Weston, Stéphane Payen, Fred Van Hove et moi-même, terminons ce cycle avec celles de Guy Le Querrec, Adam Linz et Bernard Vitet !
Réponses réunies par Laure Nbataï, Raymond Vurluz et Valérie Crinière et parues début 2005 dans le n°12 du Journal des Allumés du Jazz
Dans le cadre du Cours du Temps, nous avons l'habitude de retracer l'histoire de musiciens qui ont marqué le demi-siècle passé. Pour ce numéro, nous marquons une pause en vous proposant des petites histoires, celles d’occasions manquées, de rêves qui tournent court. Le Cours du Temps en aurait-il été affecté ? Le leur, le vôtre, le nôtre ?
Michèle Morgan sous les flashes par Guy Le Querrec
Même si la petite histoire que je choisis de raconter remonte à un bon
bout de temps, plus de 35 ans, elle ne s’est jamais dissipée dans les
brumes des eaux qui coulent le long des quais. Le « il était une
fois » se passe en 1967, le mardi 27 octobre très exactement, durant la
période de mes tout débuts, bien incertains, dans le métier de
photographe. Je fais à cette époque équipe avec un copain un peu plus
aguerri que moi, Philippe Mousseau, ex-assistant de Jean-Pierre Leloir,
l’œil le plus réputé du jazz dans notre hexagone. Notre travail était
diversifié, comprenant au gré des clients, une partie labo
(développements et tirages) et de petites prises de vue. Les commandes
sont rares et la plupart du temps modestes.
Survient alors une commande imprévisible et plus conséquente. Le mensuel
féminin de la CGT, Antoinette, me sollicite pour photographier Michèle
Morgan chez elle dans son très bel appartement de l’île Saint-Louis
pendant son interview. Il est prévu, par ailleurs, qu’elle s’habille de
la robe choisie pour son réveillon de Noël, petite exclusivité offerte
aux lectrices dans le numéro de décembre. La journaliste, Mary Cadras,
soucieuse de l’image de son magazine, me demande de lui garantir
d’apparaître, pour la circonstance, sûr de moi et professionnel. On
convient alors avec mon partenaire qu’il jouera le rôle de l’assistant,
valorisant ainsi mon statut de photographe et celui d’Antoinette. Pour
donner encore plus d’allure à notre apparition, nous décidons
d’accélérer l’achat prévu de deux flashes électroniques Balcar avec
cellule photoélectrique d’occasion à un collègue photographe de mode.
Dans la précipitation, il n’avait pu que nous donner des explications
très succinctes sur le mode d’emploi du matériel.
Le photographe, son assistant et le prestigieux matériel se retrouvent
donc avec la journaliste et ses recommandations, flattée et
impressionnée de rencontrer une star du 7e art. De mon côté, j’avais du
mal à me soustraire à l’appréhension de me retrouver face à une vedette
que je n’avais rencontrée jusqu’alors que sur l’écran du cinéma de mon
quartier, à la séance de neuf heures du soir.
Tout se met en place, l’interviewée, l’intervieweuse et, bien entendu,
les deux flashes Balcar, avec leur parapluie pour diffuser la lumière,
placés à environ 1m50 du “modèle”. Arrive le moment fatidique de la
mesure du temps de pose. À la lecture du premier éclair, 122 de
diaphragme s’affiche sur le posemètre, réglage inatteignable sur les
objectifs de nos appareils, comme sur tout autre existant sur le marché.
Incompréhensible ! Mon assistant plus expérimenté ne s’affole pas.
Je ne partage pas sa quiétude mais le laisse modifier les
réglages : réduction de l’intensité de l’éclairage de moitié et
éloignement des lampes. D’abord 3 mètres, puis 4, puis 6, jusqu’à la
limite extrême du salon qui mesure bien 10 mètres ! Plus on recule,
plus mon inquiétude grandit. Nous sommes à coup sûr dans l’aberration,
l’absurde et le ridicule, et dans les grandes largeurs.
Action. Il faut malgré tout déclencher. Ce n’est qu’après le dernier
déclic que je comprends l’erreur : conséquence de notre coupable
ignorance technique, nous avons utilisé la mauvaise échelle de la
cellule photoélectrique (lumière forte au lieu de lumière faible).
Résultat : sous-exposition d’au moins 10 diaphragmes (l’équivalent
d’un réglage pour la plage en plein soleil, pour photographier dans les
couloirs du métro !). Foutu, sans espoir. On va tout de même développer
les films plus de deux heures au lieu des huit minutes préconisées. Sur
les négatifs Michèle Morgan apparaît à peine en silhouette et
l’inquiétude se transforme en panique. Que faire ? Surtout ne pas
prévenir la journaliste sortie rassurée de l’interview et de la prise de
vues, de nous avoir vus assumer avec aplomb nos fonctions. Téléphoner
pour l’informer de notre ratage est inenvisageable. Apprendre à Michèle
Morgan notre infortune, je ne m’en sens pas capable.
Il faut pourtant prendre une décision. Je choisis le chemin à moi le
plus accessible, celui de l’escalier de service arrivant dans la
cuisine. Je frappe à la porte, c’est la cuisinière qui ouvre. À elle,
j’ose raconter notre mésaventure, sans préciser toutefois les causes de
ce ratage technique, de cette occasion manquée, qu’il faut pourtant
réussir sous peine de sanctions sérieuses. La cuisinière, très attentive
à nos déboires, m’explique qu’elle va en parler à Madame Morgan qui,
selon elle, est très gentille. Elle acceptera donc vraisemblablement de
simuler l’interview et de se revêtir de sa robe de Réveillon. Je dois
revenir le lendemain pour connaître la décision de Madame Morgan.
C’est d’accord. On recommence donc la séance de rattrapage le vendredi
27 octobre. Fortuna. Coup de chance, dehors le soleil brille et inonde
d’une très belle lumière naturelle le grand salon. Plus besoin d’allumer
les Balcar. Plus d’éclair pour essayer de faire des photos du tonnerre.
Retrouvant plus d’aisance, j’ose lui demander des poses n’ayant pas
existé lors de la première prise de vues. Heureusement que le miroir a
deux phases.
Tirages terminés, j’appelle la journaliste Mary Cadras et lui raconte
qu’insatisfait des premières photos pas assez diversifiées, j’ai préféré
demander une nouvelle séance. Pas un mot sur les causes réelles de ce
deuxième passage chez Madame Morgan.
La photo non prévue au programme a fait la double page et je suis sorti
de l’épreuve, rassuré, grandi et professionnalisé. Et elle a de beaux
yeux, tu sais ?
Fat Kid Wednesdays par Adam Linz
Quand on est jeune, on recherche les trucs qui semblent éternels. Ces
trucs magiques ! Et parfois on les trouve là où l’on s’y attendait
le moins. Depuis que j’ai douze ans, je vis dans le Minnesota, à
Minneapolis pour être précis. Un coin sympa où les gens se sentent bien
et où il y a étonnamment une scène artistique florissante. Pas seulement
l’art moderne, mais aussi la musique et la danse. Je devins musicien et
mon meilleur copain Mike acteur, je partis pour New York apprendre avec
les grands tandis que Mike resta à Minneapolis à écorner des scénarios
et à suivre des études théâtrales prétentieuses. Mais pendant les
vacances, on se retrouvait pour dénicher l’enchantement que recherchent
tous ceux qui viennent de dépasser leurs vingt ans. L’été 1994, on l’a
simplement découverte dans notre propre cour.
C’était un jour couvert de fin août. Lorsque vous êtes jeunes, il arrive
que tout ce que vous ayez à faire c’est de bosser, que ce soit la
musique ou un scénario, et de boire toute la journée. Mike et moi nous
sommes retrouvés embarqués dans la même galère ce jour-là, à bavarder et
s’emmerder. Je ne sais plus comment le sujet est arrivé sur la table,
mais nous nous sommes senti tous les deux assez en nage pour tenter une
balade jusqu’à la piscine municipale. Une piscine avec des vagues !
Mais pas une piscine à vagues à la Bunker Hills qui dépend d’un country
club avec un golf où les riches se mettent d’accord sur les prochaines
frappes contre les opprimés. Apparemment ils ont besoin d’une piscine
géante avec des vagues pour faire ça. Très bien ! En voiture et on
est parti.
Le soleil avait disparu et nous étions agréablement assis devant la
piscine, avec un verre, prêts à grignoter. Mais nous étions aussi près
de la location des bouées. En Amérique, lorsque vous avez une piscine à
vagues il faut que vous fassiez un maximum de fric, alors vous louez des
bouées pour que les enfants puissent flotter. À la demi-heure, ça
rapporte ! Mike se retourne vers moi tandis que je me remets de
notre muflée matinale : “Bon dieu de merde, regarde-les tous !
T’as vu tout ce peuple.” Je lève les yeux vers quarante gamins tous
plus larges que grands. C’est ça, des FAT KIDS (NdT : gros
gamins) !
J’étais un gosse obèse en train de grandir. Comme Mike, toujours plus
imposant que les autres. Je pense que c’était pour ça qu’on était de si
bons potes. On avait tous les deux eu la même enfance triste, tourmentés
et laissés à nous-mêmes. Ainsi nous n’étions pas simplement de vilains
adultes dégoisant sur la corpulence des enfants. Ils étaient
gigantesques. Je n’avais jamais vu des gosses aussi ronds, tous avec
entre les mains de la bouffe achetée à la guérite du snack, barres de
crème glacée et sacs de chips, soupirant pour une dernière plongée. Le
plus gros étant évidemment le grand gagnant, comme si on assistait à un
combat de sumos à Tokyo. Le maître-nageur fait une annonce : “on ne
court pas, on ne saute pas, on n’éclabousse pas.” Mike
renchérit : “et tous les gros gamins foutent le camp de ma
piscine.” Ha ha ha. C’est ainsi que dans les heures qui suivirent sont
nés les Mercredis des Gros Gamins, les Fat Kid Wednesdays.
C’est que personne ne va à la piscine le mercredi. Cette journée est
réservée aux plus lourds de nos enfants. La baraque de bouffe est fermée
et il y a des frimeurs. C’est ça, des frimeurs. Ils ressemblent à des
motards, avec leurs jeans déchirés, leurs vestes de cuir et les
piercings par-dessus le marché. Au bout du bassin il y a trois balances à
fléau pour peser les enfants. Trop gros, vous êtes viré. Il n’y a pas
de surveillants parce que tous les enfants flottent. Si cela faisait loi
ça pourrait balayer le pays et sa gloire ne cesserait d’augmenter. De
gros gamins dans des piscines à vagues. C’est le genre d’enchantement
qu’on ne peut trouver qu’en traînant avec son meilleur ami. Tous les
deux traversant la vie à toute blinde, en se demandant si quiconque
écouterait les notes ou les mots. Et ces Fat Kids, que leur
arrivera-t-il ? Certains disparaîtront sous l’opinion publique.
D’autres poursuivront, se souvenant de ce jour ensoleillé et partageant
cette histoire avec qui veut l’entendre. Fat Kid Wednesdays pour
toujours.
Gagné ! par Bernard Vitet
Des occasions ?
Une de perdue, dix de retrouvées...
Sans compter les occasions d'avoir raté l'occasion de rater une occasion.