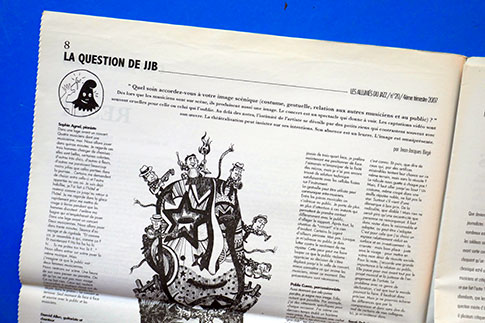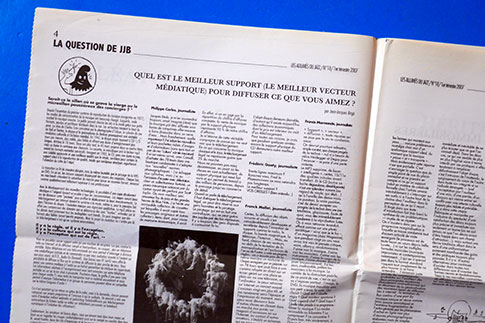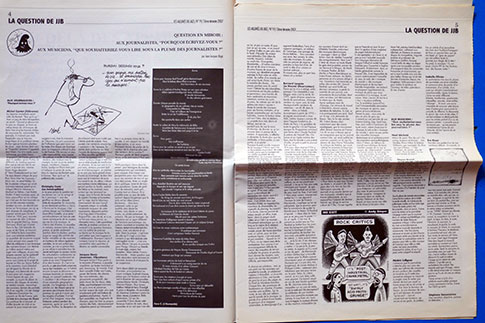vendredi 7 août 2020
Bernard Stiegler, la musique est la première technique du désir
Par Jean-Jacques Birgé,
vendredi 7 août 2020 à 00:17 :: Allumés du Jazz

Début 2008, nous avions rencontré Bernard Stiegler dans la cadre d'une enquête sur la fonction de la musique aujourd'hui, que Jean Rochard et moi réalisions pour le Journal des Allumés. Je le republie aujourd'hui en mémoire du philosophe décédé hier 6 août. Il aura abrégé ses souffrances qu'il traînait depuis plusieurs mois...
Il est agréable d'interviewer quelqu'un qui se préoccupe d'abord de ses deux interlocuteurs et du médium à qui il s'adresse et que nous représentons. Bien que nous nous souvenions très bien, et avec plaisir, de son frère Dominique lorsqu'il était journaliste à Révolution, nous ignorions l'attachement au jazz de l'ancien directeur de l'Ircam, de sa passion absolue pour cette musique jusqu'à son emprisonnement pour vol à main armée en 1978. Stiegler eut la sagesse de faire son coming out sur ses activités délinquantes et écrivit Passer à l'acte en 2003 sur ce qui lui permit d'entrer en philosophie. La lecture d'un article passionnant sur la perte de la libido, conséquence de l'uniformisation, écrit pour Le Monde Diplomatique, nous donna envie de l'interroger sur les changements sociaux que la musique peut produire et comment sa fonction se transforme aux mains d'une industrie dont le moteur "essentiel" est le marketing.
Nous sommes surpris par son "optimisme" quant à l'avenir des nouvelles technologies lorsqu'il ne peut imaginer autre chose que l'écroulement d'un système qui a poussé la manipulation jusqu'à l'absurde, par sa désincarnation morbide et ses tentatives d'uniformisation des consciences. Il appelle "s'accaparer" ce que je nomme "pervertir", mais nous sommes d'accord sur la position à adopter face aux machines. Pour lui, l'objet est pervers et nous sommes en charge de le dé-pervertir en trouvant une façon positive de le détourner au profit de l'intelligence, de le pousser vers l'échange. Ainsi, en tapant ces lignes, j'écoute les conférences d'Ars Industrialis au format mp3. Rien ne sert de diaboliser les soubresauts technologiques, il vaut mieux apprendre à s'en servir, tout en restant vigilant sur les dérives de contrôle qu'elles risquent de générer. Le poids de Google est, par exemple, de plus en plus inquiétant.
Bernard Stiegler, actuellement directeur du département du développement culturel au Centre Georges-Pompidou, dirige également l'Institut de Recherche et d'Innovation (IRI) où il nous reçoit. La veille à Ivry, dans le cadre de Sons d'Hiver, eut lieu un débat sur la question : la musique vaut-elle encore le dérangement ? qui figurera aussi, entre autres, dans ce numéro 21.
Tous les numéros sont téléchargeables sur le site au format pdf.
Vous pouvez aussi lire les deux derniers livres de Stiegler : Économie de l'hypermatériel et psychopouvoir (entretiens chez Fayard) et Prendre soin (gros bouquin sur la jeunesse chez Flammarion).
par Jean-Jacques Birgé et Jean Rochard, transcrit par Christelle Raffaëlli, illustré par Sylvie Fontaine.

Entretien avec Bernard Stiegler par Jean-Jacques Birgé et Jean Rochard, transcrit par Christelle Raffaëlli, paru début 2008 dans le numéro 21 du Journal des Allumés du Jazz.
Le philosophe Bernard Stiegler nous reçoit dans son bureau de l’IRI (Institut de Recherche et d’Innovation) dont les fenêtres donnent sur le Centre Pompidou où il est directeur du développement culturel. Nous l’avions connu directeur de l’Ircam, mais lors de notre entretien, nous apprenons son ancienne dévotion pour le jazz à l’époque où, jeune homme, il avait un club à Toulouse, période qui se soldera par son incarcération pour vols à main armée comme il le raconte dans son livre Passer à l’acte (Galilée). Ses deux derniers ouvrages, Économie de l'hypermatériel et psychopouvoir (entretiens chez Fayard) et Prendre soin : Tome1, de la jeunesse et des générations (Flammarion), abordent des sujets qui nous sont chers. S’appuyant sur ses recherches sur les nouvelles technologies et les usages qui en découlent, Bernard Stiegler pense que le capitalisme de production devenu capitalisme de consommation s’autodétruira à force de monopoles, de contrôles et d’uniformisation, engendrant une perte de la libido et donc du désir.
Jean Rochard : Qu'est-ce que la musique a apporté à l’humanité ?
Bernard Stiegler : Une première question pourrait se poser : “quand la musique apparaît-elle?”. L’humanité (mais tout le monde n’est pas d’accord là-dessus), existe depuis deux millions d’années si l’on appelle humain un être bipède qui produit des objets techniques. Si vous demandez aux préhistoriens, la musique a 40 000 ans. À s’en tenir à la documentation préhistorique, il n’y a pas auparavant de musique, ce qui est hautement problématique.
Jean-Jacques Birgé : Je tiens une bande directement d'André Leroi-Gourhan, enregistrée en Russie avec des os de mammouth...
BS: On assigne la musique au premier instrument de musique considéré comme tel, le rhombe en os, daté de 40 000 ans. Est-ce que ça signifie qu’il n’y a pas de musique avant? J’aurais tendance à penser qu’elle commence avec l’hominisation, il y a deux millions d’années, avec le travail pour être plus précis, avec la rythmologie du travail. On ne connaît pas de société humaine sans musique. Plus les sociétés sont anciennes, plus la musique semble être importante dans la relation sociale entre les individus. Aujourd’hui, paradoxalement, un de ses aspects majeurs est qu’elle est absolument partout. Mais dans quelle mesure constitue-t-elle encore une relation sociale ? Les conditions de diffusion dominent plus que la musique elle-même. La musique, en tant qu’objet temporel, pouvant envahir le temps qui est aussi une conscience vivante, a un pouvoir sur les êtres humains qui a été en partie agencé avec le cinéma et remplacé par lui: elle a comme le cinéma un pouvoir de capter le temps de l’attention humaine. C’est aussi sa fonction dans le travail, par ses capacités de coordination, de synchronisation des individus, de leur attention, de leurs gestes, etc. Elle possède aussi un pouvoir extatique, qui se traduit par ce qu’un grand anthropologue, Gilbert Rouget, appelle la transe. Elle seule offre ce pouvoir de sortir de ses gonds. En tout cas, elle a pu le faire pendant très longtemps. C’est en fait un objet extrêmement paradoxal parce qu’elle a un pouvoir à la fois de synchronisation et de contrôle, et de singularisation extrême. Le saxophone ne s’est pas développé grâce à l’armée par hasard - et ce n’est pas par hasard que l’armée a investi au XIXème siècle dans les cuivres comme moyen de contrôle non disciplinaire et par la pénétration des âmes. Albert Ayler est devenu musicien à l’armée, et ce n’est pas par hasard.
JJB: Depuis quelques décennies, on ne peut plus aller acheter un pantalon sans être massacré par la musique mais ce qui est bizarre en même temps, c’est qu’il semble qu’il y ait beaucoup d’acheteurs potentiels qui supportent très mal…
BS: De plus en plus de gens s’en plaignent et je pense qu’on va vers des décrochages à et égard. On ne peut jamais analyser la musique seule hors de son contexte. Je suis un adversaire de l’art pour l’art. Il y a cependant une époque où l’art pour l’art s’est constitué en réaction à l’instrumentalisation de la musique par la noblesse, par le clergé, par l’armée. Il y a eu un moment faste et beau de l’art pour l’art, mais on n’en est plus du tout là : aujourd’hui l’art est pour le marketing… La musique véritable, la musique en acte, si l’on peut dire, est une pratique de mise hors contrôle - y compris par les mêmes institutions et les mêmes dispositifs qui en font un dispositif de contrôle. Je ne suis pas croyant, mais il m’arrive quand même d’assister à des offices religieux et de me sentir sous le pouvoir de quelque chose qui me fait accéder effectivement à des états tout à fait anormaux. J’ai été un passionné de musique, mais vraiment archi-passionné, je rêvais de faire votre métier d’ailleurs à un moment donné.
JR: Pourquoi le dire au passé ?
BS: J’ai arrêté d’en écouter en prison - sinon à la radio : j’écoutais Le Matin des Musiciens. À l’époque où j’ai été incarcéré, la musique était pour moi absolument vitale. J’avais créé une sorte de bistrot jazz pour pouvoir y écouter de la musique tout le temps. J’y accueillais des musiciens, j’y faisais le “ DJ”, je considérais que mon métier était de faire découvrir la musique aux autres - tout en vendant de la bière. Je passais des heures dans les magasins de disques pour essayer de trouver de bonnes choses à faire écouter. C’était une période de ma jeunesse où j’avais une pratique de l’écoute rigoureuse. Puis j’ai arrêté, d’abord parce que je suis allé en prison, et que j’ai perdu presque toute ma discothèque, peut-être aussi parce que j’ai rationalisé la situation en me disant que de toute façon toute cette histoire du jazz qui m’avait complètement habité était sans doute un peu finie. À ma sortie de prison en 1983, il y avait encore des disques magnifiques - par exemple, de Charlie Haden, Ballad of the Fallen, que m’a offert mon frère Dominique, mais j’avais l’impression que ce n’était quand même plus comme dans les années 60 ou 70 : pour moi ces années sont la grande époque du jazz moderne.
JR: Ça pourrait être une sorte de rapport d’addiction ?
BS : L’amateur est une figure du désir, et le désir est addictif. Quand vous vous retrouvez en prison sans vos objets de passion, c’est terrible, vous avez l’impression qu’on vous a arraché les bras, les jambes, la tête. Le pire pour moi, c’était la musique et l’alcool. Je ne pouvais pas commencer une journée sans me mettre un disque. Aujourd’hui, c’est totalement fini. Il y a bien là quelque chose qui est de l’ordre de l’addiction, mais c’est une addiction positive.
Pour revenir à votre question : la musique nous permet de sortir de nos gonds, elle permet à la fois le contrôle social et le passage hors contrôle. Elle est capable de produire en même temps de la synchronisation et du diachronique, c’est-à-dire de la singularité, de l’improbable, et de l’improvisation. La première musique que j’ai écoutée, c’était de la musique classique. Ma mère – dans ma famille, nous étions de condition modeste, comme on dit, mais mes parents, et surtout ma mère, faisait partie de ce monde populaire qui croyait à la culture et voulait que ses enfants soient bien éduqués – ma mère achetait ainsi des disques par l’intermédiaire de ce qui était alors la Guilde du Disque, et c’est ainsi qu’enfant, j’ai découvert, Schubert, Beethoven et quelques autres. Quant au jazz, je crois que j’ai commencé à en écouter en 64-65. C’était le début du free jazz, Coltrane était en pleine activité. J’habitais Sarcelles. Ce n’est pas très drôle d’habiter Sarcelles. Mais Sarcelles en écoutant Coltrane ou Mingus, c’est beau et grand, cela promet.
JJB : C’est une époque unique au niveau artistique en général et pour l’imagination.
BS : C’est vrai. Il n’empêche que je trouve que le jazz est à part. D’abord parce que cette musique est d’une qualité incroyable et littéralement miraculeuse. C’est une musique d’une très grande précision qui s’est inventée en très peu de temps. Il y a bien entendu aussi de belles inventions dans le rock, dans le rhythm and blues, mais dans le jazz, il se passe quelque chose d’incroyablement resserré, d’extraordinairement intense. C’est mon histoire : je vous restitue la chose comme je crois me souvenir de l’avoir vécue. Par ailleurs, un concours de circonstances a fait que je me suis retrouvé à habiter, après avoir quitté Sarcelles, à 300 mètres du Chat qui Pêche. Du coup, je me suis mis à rencontrer des musiciens, beaucoup de musiciens. C’est un peu après cette époque que j’ai monté mon bar musical à Toulouse, en étant passé par diverses aventures. De nos jours la musique est devenue un outil de contrôle extrêmement trivial. Autant les industries culturelles dans les années 40, même 30, aux États-Unis ont une grande inventivité, une grande intelligence, justement en matière de production et d’organisation de la production essentiellement américaine, autant aujourd’hui je pense que c’est la bêtise absolue qui domine de façon écrasante, non que les gens sont bêtes, mais on ne croit plus du tout à autre chose qu’au marketing.
JJB: La religion précède…
BS: La religion c’est autre chose, tout autre chose que le marketing - et ce fut très inventif. Il n’y guère de rituel ou de culte sans musique. La musique, comme phénomène temporel qui épouse le temps de la conscience, qui y entre et l’envahit, a un pouvoir unique à cet égard, jusqu’à l’apparition du cinéma. Jusqu’au cinéma, il n’y avait que deux manières de contrôler le temps des consciences des individus, c’était ou la musique, ou le discours, mais les deux, musique et paroles, c’est à dire chant, poésie - mais dans tous les cas, ce que Husserl décrit comme des objets temporels.
En ce moment même, je suis en train de parler : je produis un objet temporel, qui est d’ailleurs une sorte de musique en réalité, dans la mesure où la voix est un instrument de musique très spécial, un instrument que tout le monde pratique sans le savoir - la langue est une sorte de musique, et c’est ce qu’enseigne la poésie. C’est aussi ce que l’on découvre quand on va au Vietnam et qu’on ne parle pas vietnamien : on découvre dans cet idiome dont la prosodie est si différente de la nôtre une sorte de musique. Sur un autre registre, si j’ose dire, on doit réfléchir à ce que raconte Giono, à propos d’un village de Provence où, pendant les guerres de religions, on avait arraché la langue à tous les habitants du village : ils se mirent à jouer de l’harmonica, raconte Giono. L’harmonica ne peut ainsi remplacer la langue que parce que celle-ci a d’emblée quelque chose de musical.
Au moment où arrive le cinéma, un nouvel objet temporel apparaît, qui capte temporellement l’attention par les yeux, et puis se développe l’énorme machine de ce qu’on appelle l’audiovisuel. On voit maintenant avec l’iPod se répandre de nouvelles façons d’écouter. Tout cela bouge énormément - et c’est l’organologie du problème. L’organologie générale que j’essaye de théoriser analyse les conditions techniques, les conditions corporelles - y compris le cerveau et l’appareil psychique qui s’y forme - et les conditions sociales qui relient les appareils psychiques et qui sont leurs autres conditions de fonctionnement. Les conditions corporelles, ce sont les organes, l’oreille, la langue, les mains, le cerveau; les conditions techniques, ce sont les organes artificiels; et les conditions sociales, ce sont les organisations, tout cela étant inséparable. Un organe humain n’est jamais sans organe technique et un organe technique n’est jamais sans organisation sociale.
JJB: Tout ce qui est dématérialisation des supports relève de formats qui ne correspondent pas du tout, pas plus à la musique contemporaine qu’à la musique que nous produisons. Des formats chansons en définitive.
BS: Le mp3 est un vecteur technique qui est aujourd’hui investi - le mp3 et l’iPod font système - par des gens qui ont compris, il y a quinze ans, aussi bien Microsoft qu’Apple, que le multimédia était l’avenir de l’informatique. Cela m’intéresserait d’ailleurs de savoir ce que vous pensez de la mort du disque.
JR: Je pense que c’est la musique qui est attaquée en fait au travers du disque. Je ne pense pas que le disque soit un objet sacro-saint, mais un objet très curieux qui a pris une sorte d’autonomie dans la manière dont il va se séparer de l’exécution publique pour devenir un endroit…
BS: Ce dont Coltrane est un point culminant…
JR: Un endroit de création, soit effectivement par le rapport que peut avoir un musicien comme John Coltrane au studio, c’est-à-dire qu’il appelle son producteur Bob Thiele à 5 heures du matin en disant “ j’ai une idée, il faut qu’à 8 heures j’ai les musiciens, etc. “, soit sur le versant des musiques de rock par tout un tas de techniques qui sont nées du désir des musiciens de changer. Par exemple, le multipiste arrive à cause ou grâce aux Beatles, etc. Jusqu’à un certain moment, on a l’impression que la technique suit le désir, l’expression, ce qu’on cherche. Et puis à un moment ça s’inverse. La technologie arrive avant, et on dit “ qu’est-ce qu’on en fait” ?
BS: Je n’en suis pas sûr. J’ai envie de dire qu’il faut se réjouir du fait que le disque disparaisse, d’une certaine manière. Si mon éditeur m’entendait, il serait furieux, mais j’aurais aussi envie de dire qu’il y a peut-être quelque chose de bon à attendre du fait que les éditeurs disparaissent. Tous ces systèmes ont installé des logiques auxquelles nous nous sommes habitués. Je voudrais revenir sur ce que vous disiez à propos du disque. Je comprends ce que vous dites sur le multipistes, mais pour que le multipistes existe, il fallait qu’avant il y ait aussi quelque chose qui était une technologie qui précédait les Beatles. En fait, il n’y a jamais rien qui précède le reste : c’est cela que j’appelle l’organologie générale, c’est un complexe où les trois instances dont je vous parlais tout à l’heure sont en relation. Et puis il y a des moments où ces relations sont investies par un immense désir. Le deuxième instrument de Charlie Parker, c’est le phonographe et chez lui, le disque, qui est encore le 78 tours à ce moment-là, est son espace d’écriture. Contrairement à tout ce qu’on dit, je pense que le jazz est toujours écrit, et que le jazz est intrinsèquement lié au disque. Le disque est la surface d’inscription du jazz.
Le fait que le disque disparaisse est extrêmement problématique pour mille raisons, comme chaque fois que quelque chose disparaît dans la société, mais ma façon de voir me fait dire qu’il faut toujours investir le côté intéressant de la catastrophe. Ce qui m’intéresse, ce n’est pas le mp3, ce sont les pratiques sociales qu’il y a derrière et les désirs qui peuvent s’y former. Les mômes qui font des playlists sont bien entendu sous la pression du marketing, mais ce dont ils ont envie, c’est de donner à connaître aux autres ce qu’ils aiment : c’est une vraie dimension de cette pratique, aussi embryonnaire et pauvre qu’elle puisse être. Qu’est-ce qui se passe quand les mômes s’envoient des machins ? Ils s’envoient leurs goûts. Ce qui investi le système mp3/playlist/iPod, c’est le désir de reconnaissance, c’est-à-dire ce qui fait du désir une force sociale.
JR: À la Fontaine des Innocents, tous les vendredis, des gens se retrouvent pour danser ensemble avec des iPods, sur des musiques complètement différentes…
JJB: Il y a un isolement provoqué par les nouvelles technologies et ces objets ont quand même tendance pour le moment à être des objets assez autistes.
BS: Chaque fois qu’une technologie se développe, elle produit de la casse et des comportements pathologiques à cause de la casse qui est produite. Simplement, que l’on soit artiste ou intellectuel, on a une responsabilité: celle de faire que le monde tel qu’il est tire parti de cette nouveauté. Bien sûr l’iPod, les lecteurs DVD peuvent produire des choses terrifiantes. Je puis les dénoncer, mais ce n’est ni intéressant ni surtout légitime si je ne suis pas capable de proposer d’autres pratiques de ces nouveaux organes. Pour les étrennes, juste après Noël, ma belle-mère a offert à ma fille de 8 ans un baladeur mp3. Mon enfant, je la protège : il n’y a pas de télévision à la maison, pas de jeux vidéos, rien de tout cela. Et puis voilà que la grand-mère débarque et qu’Elsa dit “ j’ai mon mp3 ! j’ai mon mp3 !”. Maintenant que le mp3 est là, ma responsabilité est d’apprendre à faire quelque chose d’intelligent avec elle, et aussi de lui faire confiance pour autant que je ne la laisse pas abandonnée à “ son mp3”. Quand Bartók a parlé de la radio en 1937 (au moment où Parker pratiquait son phonographe pour écouter Lester Young en le ralentissant, ce que Bartók faisait d’ailleurs aussi et au même moment avec les musiques tziganes), il a dit : “ N’écoutez pas de musique à la radio - sauf si vous ouvrez la partition et si vous la lisez en même temps. ”
JJB: Qu’est-ce qu’on peut faire aujourd’hui ?
BS: La musique, il faut d’abord l’écouter. Mais pour moi, un amateur de musique ne se contente pas d’écouter. Quand j’écoutais des concerts de jazz, j’avais d’abord tendance à préférer les enregistrements aux concerts et surtout ce qui m’importait, c’était ensuite de repasser tel machin et de le réécouter cinquante fois de suite. Je me les incrustais dans la tête, et je les rapprochais d’autres morceaux de ma discothèque. Avec mon frère Dominique, nous passions des week-ends à faire cela avec nos amis - à pratiquer ce que l’on appelle depuis le XIXème siècle le comparatisme. J’ai aussi été cinéphile, et je lisais des découpages techniques après avoir vu le film. L’Opéra de Paris, vers 1880, diffusait des guides d’écoute, des réductions pour piano des partitions d’orchestre et des analyses des partitions pour son public qui pouvait ainsi pleinement apprécier sa programmation. Des milliers de gens lisaient cela chez eux, et ne se contentaient pas d’aller au concert. Les nouveaux organes, iPods, sites Internet, etc., sont des instruments pour redévelopper l’esprit critique et les communautés d’amateurs.
Aujourd’hui le consumérisme imposé à la jeunesse a pris des proportions colossales et il est extrêmement difficile pour les jeunes gens de sortir d’un modèle presque complètement ficelé par le marketing. Et en même temps, il y a des changements de comportement intéressants. Dans la crise de l’industrie du disque, il y a aussi un phénomène de rejet d’un système étouffant. Notre responsabilité, à nous, les gens qui sommes dans les métiers que nous faisons, c’est d’apporter des possibilités nouvelles.
Je discute beaucoup avec les industriels : il n’y a pas que des êtres vénaux dans le monde industriel, il y a là aussi des gens qui croient à ce qu’ils font, qui pensent à d’autres choses, et puis surtout, moins angéliquement, il y en a beaucoup qui sont très inquiets. Il y en a par exemple qui réfléchissent à constituer ce que j’appelle des appareils critiques autour des concerts, qui ont repris de la vigueur. À l’Institut de Recherche et d’Innovation du Centre Pompidou, nous développons un logiciel de production d’appareils critiques pour le cinéma, Lignes de temps.
Aujourd’hui, avec le Net, la logique production/consommation ne fonctionne plus. La société, surtout la jeunesse, n’a peut-être jamais été aussi désorganisée dans toute l’histoire de l’humanité. Et pourtant, il y a chez ces jeunes gens-là quelque chose qui résiste à cet état de fait. Ce n’est pas du tout la même chose que nous dans les années 60… C’est sur eux qu’il faut compter, sur leurs manières… Si nous ne les abandonnons pas en nous abandonnant à nos propres fantasmes.