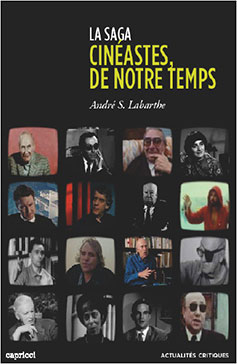vendredi 25 septembre 2015
Spartacus et Cassandra
Par Jean-Jacques Birgé,
vendredi 25 septembre 2015 à 00:12 :: Cinéma & DVD
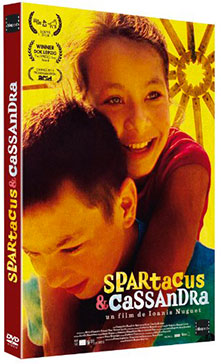
Théo est en seconde en section cinéma. C'est chouette ces spécialisations qui ne sont pas téléguidées par le monde de l'entreprise ! À son âge ma fille avait carrément choisi de changer de lycée pour suivre "cirque et études" à Georges Brassens, cirque le matin, lycée l'après-midi, mais avec le même programme que les élèves des autres établissements. On pouvait donc y passer moins de temps pour se livrer à des activités plus épanouissantes ? Après 1968 il y avait juste une fille parmi des milliers de garçons à Claude Bernard parce qu'elle faisait dessin, et un seul garçon à Lafontaine parce qu'il avait choisi musique ! Cela marquait le début de la mixité. Pour les activités extra-scolaires on ne pouvait compter que sur soi. J'allai à la Maison des Jeunes écouter des conférences, des copains avaient créé un ciné-club au lycée, j'y avais organisé le premier concert de rock... Après le bac j'étais rentré à l'Idhec un peu par hasard, réussissant le concours contre toute attente et surtout la mienne. Je ne réalise pas souvent de films, mais le cinéma exerce une influence considérable sur tous mes travaux. Théo m'a donc conseillé de regarder Spartacus et Cassandra qui lui avait beaucoup plu. Le film vient de sortir en DVD.
Spartacus et Cassandra est un vrai documentaire, pas un reportage télé comme on nous en sert trop souvent, de la radio projetée sur grand écran. La banalité donne une image exécrable du documentaire. Pourtant lorsque le sujet suggère sa forme ou qu'un cinéaste, comme ici Ioanis Nuguet, soigne autant le style que le récit le documentaire acquiert ses lettres de noblesse.
Spartacus et Cassandra est un film sur l'enfance et l'adolescence, de celles qui nous habitent et nous font vivre, ou qui nous échappent et nous figent dans des rituels de mort prématurée. Le réalisateur a choisi de ne rien livrer d'autre que ce qui est perçu par son personnage principal, un gamin Rom, retiré à ses parents par la justice et confié avec sa petite sœur à une bonne fée, jeune et dégourdie. Les zones de mystère ne manquent pas de nous interroger, mais l'on sait bien que ces questions viennent nous tarabuster plus tard. Spartacus a déjà fort à faire avec son père à la rue et sa mère complètement paumée. La circassienne Camille dresse un pont entre les gens du voyage et le monde des rêves, offrant aux deux petits Roumains la possibilité d'échapper à la misère et à la délinquance. Nuguet, que l'on suppose intime de la trapéziste, jongle avec sa caméra pour trouver des angles où la fantaisie et l'imagination réfléchissent le réel. Il soulage les moments difficiles où la tristesse et la révolte s'emparent de Spartacus pour fabriquer un conte dont les enfants sont les premiers auteurs, paradoxalement plus sages que leurs deux parents. Tels Les contrebandiers de Moonfleet ou La nuit du chasseur, ce film initiatique apporte aux enfants la lumière en chassant les ombres maléfiques que les adultes agitent en toute inconscience.
→ Ioanis Nuguet, Spartacus et Cassandra, DVD blaq out avec en bonus un entretien avec le réalisateur, l'atelier slam, un cours de trapèze, la poule trapéziste, etc., 18,90€