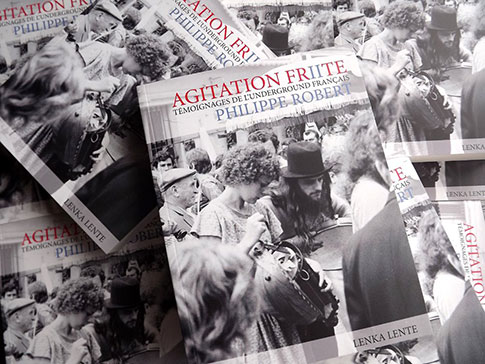En avril 2004 j'avais réalisé une enquête sur les intermittents du spectacle pour le numéro 547 de Jazz Magazine. Rien n'a changé, tout a empiré. J'ai raconté
ici mon parcours du combattant. Le gouvernement vendu aux banques essaiera encore de se débarrasser d'un statut qui permet à notre pays de rayonner encore un tout petit peu par sa culture, du moins il y participe. Mais les crédits sont systématiquement coupés, les festivals ferment, les scènes nationales deviennent des coquilles vides, les artistes peinent de plus en plus. Dans le même temps nos ventes d'armes augmentent et les patrons des grosses sociétés et leurs actionnaires se gavent sur le dos des pauvres. Il est néanmoins difficile de délocaliser la culture, à moins de n'avaler plus que du MacDo formaté muzak et blockbusters, ce qui réglera la question en renvoyant les trublions se faire matraquer par la police et l'armée. J'ai eu toutes sortes de pensées cahotantes hier soir en comptant les dizaines de cars de police cachés dans les rues parallèles au boulevard Saint-Michel, remplis de Robocops prêts à rentrer dans le lard des étudiants qui rêveraient d'un nouveau joli mai. Leurs ordres étaient clairs à Notre-Dame-des-Landes. Mais revenons plus simplement à cette enquête...
Devenir musicien ou musicienne de jazz n’a rien d’un rêve de midinet(te). On ne vise pas la notoriété. Cela commence en général par une passion, et de gammes en rencontres, vous voilà passé(e) professionnel(le). La question de la subsistance peut alors devenir prépondérante. Mais d’abord comment vit-on, et en vit-on ? Quelle organisation du temps implique cette activité ? A une époque où les salaires stagnent tandis que les prix augmentent, où le statut d’intermittent dérange le patronat plus intéressé à promouvoir la consommation qu’à défendre la culture, il est plus que temps d’essayer de comprendre comment vivent les artistes et quelles sont leurs chances de perdurer dans un monde où le profit est devenu la règle d’or.
I. Intermittents du spectacle
Pourquoi les artistes ne cèderont pas
Un régime salutaire
Les artistes et techniciens du spectacle ne dépendent pas du régime général de l’assurance-chômage mais des annexes VIII et X. Cette dernière, mise en application en décembre 1969, concerne le spectacle vivant dont font partie les musiciens, tandis que la première regroupe les professionnels de l’audiovisuel. Salariés intermittents à employeurs multiples, ils sont sans cesse à la recherche d’un emploi, et alternent les périodes de travail et d’inactivité. Pourtant, on peut difficilement parler de chômage proprement dit, car rémunérés ou pas, les artistes continuent à œuvrer avec la même intensité, parfois même avec encore plus d’ardeur dans les moments sans emploi.
En effet, les artistes musiciens (puisque c’est leur cas que nous évoquons ici, et c’est ainsi que leur profession est inscrite sur leur feuille de salaire) ne sont en général rémunérés que lors de leurs prestations scéniques ou des enregistrements. Si les répétitions sont parfois payées (c’est plutôt rare dans le jazz), le temps de l’apprentissage d’un nouvel instrument, les exercices pour rester à niveau (ou pour l’atteindre !), la recherche incessante de nouveaux contrats, le temps passé à se faire payer, l’entretien et l’acquisition de ses instruments de travail, la fréquentation des concerts (en tant que spectateur) que nécessite son appartenance au milieu musical, etc. ne sont pris en charge par aucun employeur. Comment s’en sortir alors (avons-nous le choix ?) sans une aide de l’État ou des collectivités locales et régionales, sans la solidarité interprofessionnelle, sans une loi qui permette à la culture de continuer à se perpétuer ou à s’inventer ? Les artistes ne se considèrent jamais comme des chômeurs longue durée. Ils ont pourtant besoin d’un régime qui leur permette de prendre le temps de réfléchir, de composer, d’inventer, de travailler à plein temps pour leur art, leur métier.
La place du compositeur est encore plus dramatique, et souvent le musicien de jazz (ou assimilé) cumule ce poste avec son rôle d’interprète, car rares sont les commandes rémunérées. Le compositeur ne bénéficie pas du statut de salarié intermittent, il ne peut compter que sur ses droits d’auteur qui, dans le domaine du jazz, sont le plus souvent inexistants. Il peut toujours espérer une commande de musique de film et que celui-ci passe à la télévision, de préférence sur TF1 (dix fois plus payant qu’un passage sur Arte par exemple). Les ventes de disques rapportent des sommes plutôt symboliques en royautés, et les droits de reproduction mécanique n’ont d’effet réel que pour quelques uns.
Alors les musiciens pointent au chômage. Ils le font en renvoyant leur carte de pointage au début de chaque mois. Ils doivent pour cela attendre de recevoir leur carte mensuelle et la renvoyer illico. En cas de perte par la poste, ils sont immédiatement radiés et doivent courir se réinscrire à leur agence pour l’emploi. Bien qu’ils soient souvent en déplacement, ils n’ont pas la possibilité, qu’ont les chômeurs du régime général, de pointer sur Internet. Mais là, nous entrons sur un terrain miné, celui de la bureaucratie à la française. Pointer au chômage pour percevoir ses droits pourrait facilement être assimilé à un travail, tant la course d’obstacles peut s’avérer retorse.
Encore faut-il remplir certaines conditions pour percevoir des indemnités. Jusqu’à cette année, il fallait réunir 507 heures sur 12 mois pour pouvoir bénéficier des allocations chômage du régime des intermittents du spectacle. Cela équivaut également à 43 cachets isolés. Ne croyez pas que cela soit facile ! Sauf pour les quelques musiciens qui ont le vent en poupe, 43 dates c’est beaucoup dans une année, particulièrement pour les jeunes qui débutent. Le taux de l’indemnité est fixé par le montant moyen des salaires perçus pendant cette période. Être inscrit au chômage permet en outre d’être pris en charge par la Sécurité Sociale en cas de maladie.
Il y a hélas beaucoup plus d’artistes qui ne remplissent pas ces conditions que de chômeurs secourus. On frise alors la misère comme cela se pratique dans la plupart des autres pays européens. Le statut des intermittents du spectacle est une exception culturelle dans le paysage mondial. La renommée de la France à l’étranger, sa place sans commune mesure avec son rôle économique, tiennent justement à son image de pays de la culture. La protection du droit d’auteur par la SACEM ou la SACD participe aussi à ce mouvement de résistance. La Loi Lang de 1985 sur les droits voisins, gérés par la SPEDIDAM et l’ADAMI, accorde aux interprètes des droits qu’ils sont susceptibles de percevoir lorsque les œuvres auxquelles ils ont participé sont rediffusées. C’est pourquoi les artistes se battent et ne cèderont pas devant l’arrogance criminelle et suicidaire d’un patronat stupide et inculte, qui impose sa loi à un gouvernement semblant ne plus avoir d’autre pouvoir que celui de brader les richesses de l’État, son patrimoine culturel, ses racines les plus profondes, son terreau le plus fertile.
Les racines du bien
Depuis plus de dix ans, le patronat n’a de cesse de tenter de réduire ou supprimer un régime qui lui coûte plus qu’il ne lui rapporte. Car le capital n’a de logique que celle du profit direct et à court terme, il ne se soucie certes guère de l’exception culturelle ! Le parti socialiste, lorsqu’il était au pouvoir, a repoussé toute initiative qui aurait envenimé le dialogue avec le Medef (Mouvement des Entreprises de France), la droite a entériné ce qui était depuis longtemps programmé. On peut penser que ce sont les artistes qui font les frais de ces politiques désastreuses, or c’est tout le pays qui est concerné et qui risque de sombrer dans l’obscurantisme et la déchéance, tant spirituelle qu’économique.
Dans les familles, c’est souvent pire : les « saltimbanques » sont le plus souvent considérés comme des parasites de la société, qui ne produisent aucune valeur marchande, passent leur temps à rêver, sont à la charge de ceux qui travaillent, une espèce de fainéants assistés ! Pourtant la culture, qu’ils véhiculent, mieux, dont ils sont les auteurs, tisse une sorte de rhizome qui constitue les racines-mêmes d’un pays, d’une région, d’un peuple. Ne pas les protéger, ne pas les encourager, c’est vouer la nation à un déclin rapide, une barbarie sans mémoire, un avenir sans fondement, un cauchemar où tout serait chiffrable, étiquetable, formaté, uniformisé, en un mot, rentable. Évidemment c’est inverser les rôles, car sans culture il n’y a plus de peuple.
C’est également idiot d’un point de vue mercantile, on l’a constaté l’été dernier lorsque les commerçants ont commencé à se plaindre du manque à gagner par l’annulation des festivals. Hôteliers, cafetiers, restaurateurs, épiciers, boulangers, transporteurs, etc. vivent d’un tourisme attiré par les manifestations culturelles. Ces événements emploient des artistes et des techniciens qui sont le plus souvent intermittents du spectacle. L’art n’est pas un pays à part, il est enraciné dans la vie quotidienne. Imaginez que les intermittents de l’audiovisuel fassent grève, ce seraient des soirées sans télé, perspective plutôt chouette rétorqueront avec (mauvais ?) esprit les plus radicaux… On comprendra donc que sans culture s’écroule tout un pan de l’économie.
Les exemples du gâchis existent. Regardez ce qui se passe en Italie aujourd’hui. Ou hier en Allemagne. Ou encore en Chine ou en Union Soviétique pendant la période du réalisme-socialiste. Combien d’années faudra-t-il à ces nations pour remonter la pente ? L’originalité d’une culture fait la force d’un peuple, sa langue est son vecteur. Ce n’est pas un hasard si en France, les musiques traditionnelles les plus vivantes (à ne pas confondre avec les musiques folkloriques) sont celles des peuples les plus résistants : Bretagne, Corse, Pays basque…
La peau de chagrin
Tentons de résumer brièvement les nouvelles dispositions de la loi qui a mis en colère les artistes du spectacle vivant, au point de lancer une grève radicale l’été dernier (un véritable drame pour des professionnels qui n’ont d’autre passion que leur métier et déjà du mal à réunir leurs heures). Saluons au passage l’imagination dont ceux-ci ont souvent fait preuve pour manifester sans trêve leur refus de disparaître !
Il faudra donc avoir travaillé minimum 507 heures au cours des 11 mois précédant la fin du dernier contrat au lieu de 12 (10 mois et demi à partir de l’année prochaine, et ensuite ?), pour pouvoir percevoir des allocations pendant 8 mois. À partir de la date anniversaire, redevenue mobile et correspondant à la fin des 8 mois indemnisés (ajouter les jours déclarés pour la localiser), aura lieu un nouvel examen des droits. Maximum 55 heures d’enseignement pourront être comptabilisées pour le calcul des heures, le délai de franchise sera réduit de 30 jours et il n’y a plus la dégressivité de 20% après les 3 premiers mois. Le montant de l’allocation sera fonction du salaire mais aussi du nombre de jours travaillés. Le montant des allocations est comme d’habitude très compliqué à calculer, mais à la lueur des fascicules consultés on peut tout de même comprendre que ce sont les jeunes et les plus démunis qui seront exclus du régime (les conditions d’admission se durcissent) alors que les plus à l’aise restent encore les mieux lotis. Précisons qu’il y a toujours eu des plafonds qui empêchent les plus riches de le crever, et que l’examen du texte du protocole révèle chaque semaine son lot de nouvelles dispositions perverses tendant à vous empêcher de bénéficier du régime.
Des mesures de contrôle des fraudes sont annoncées, mais quelles sont leurs réalité et efficacité lorsqu’on sait que ce sont les entreprises tant publiques que privées, et non des moindres, le plus souvent de l’audiovisuel, qui ont généré le « déficit » des Assedic en déclarant d’autorité comme intermittents des salariés qui n’en ont pas le statut. Dans le jazz, certains tourneurs ou agents abusent aussi de ce système. Mais s’est-on donner les moyens de ces contrôles ?!… À la télé, les salariés sont muselés, menacés de licenciement s’ils dénoncent l’escroquerie dont ils sont les victimes et, malgré eux, les complices. Cela explique que les manifestations de résistance sont surtout le fait des artistes du spectacle vivant. Ainsi le patronat fait payer une partie de son salariat à plein temps en le déclarant à mi-temps et en facturant la différence aux Assedic, donc aux intermittents puisque leurs allocations sont réduites sous le prétexte de résorber ce déficit ! Rappelons que la nouvelle loi a été signée par le patronat (Medef), le gouvernement (jamais il n’aura compté autant de fossoyeurs parmi ses membres) et trois syndicats minoritaires (CFDT, CFTC, CGC) qui ne sont absolument pas représentatifs du milieu du spectacle. Les artistes n’ont pas d’autre choix que de se battre, mais n’est-ce pas pour eux constitutionnel ?
Il est hélas à prévoir que la peau de chagrin du régime des intermittents n’est pas le pire à venir : la décentralisation et la déconcentration des moyens risque bien de sonner le glas de toutes les professions artistiques en but aux attaques assassines du libéralisme le plus sauvage. On sera bien forcés d’y revenir…
II. La vie des bêtes
À côté de la loi et des chiffres, il y a la vie de tous les jours, les petites magouilles pour s’en sortir, la dure réalité des faits. Les règles perverses poussent à la perversité. Il est souvent préférable de toucher des salaires plus élevés sans trop dépasser les 43 cachets, éviter de déclarer plus de 4 jours consécutifs (4 cachets valent 48 heures tandis que 5 en valent 40 !), ne pas rester un mois sans cachet, déclarer plutôt sur les derniers mois pour ne pas risquer que certaines dates ne soient pas prises en compte, quelques uns vont jusqu’à « acheter » les heures qui leur manquent, etc. Ces petites combines salvatrices ne signifient pas grand-chose au regard des magouilles juteuses des employeurs, dont l’État lui-même fait partie.
Au moment de calculer sa retraite, Bernard Vitet dut faire jouer sa notoriété car jusqu’en 1968 il était généralement payé de la main à la main et en liquide. Il était pourtant un des deux trompettistes que le monde de la variété et du jazz s’arrachait. Ses allocations de retraite atteignent ainsi généreusement 700 euros. Il pense qu’il lui aurait mieux fallu se battre à l’époque pour cotiser et en profiter aujourd’hui. C’est aussi une responsabilité civique vis-à-vis de l’ensemble de la profession. Il donne quelques cours, récemment à des acteurs jouant des rôles de trompettiste au cinéma (Romain Duris, Samuel Le Bihan), joue avec des jeunes venus de la scène électro et compose. Il s’angoisse terriblement pour l’avenir. Toujours sur son Sportser 883 Harley, il me dépose devant un vieil immeuble du Marais.
Deuxième étage sans ascenseur, bordel ambiant mais organisé. Pablo Cueco me reçoit dans son bureau où s’alignent sur une estrade un ensemble de zarbs habillés de petites couvertures. Pablo ne s’est jamais beaucoup préoccupé de sa subsistance, ça a toujours plus ou moins marché. Il a déontologiquement alterné des phases avec et sans Assedic, en fonction de ses activités. Lorsqu’il avait de nombreuses commandes d’événementiels, il considérait anormal de percevoir des indemnités de chômage. Pablo a toujours fait très attention de ne pas trop se créer de besoins, qui feraient grimper son minimum vital, augmentant les frais fixes, rendant pénibles les périodes économiquement faibles. Avec sa compagne, Mirtha Pozzi, également percussionniste, ils ont été poussés à acheter leur appartement de 40 m2 pour ne pas être mis à la porte. Ils en paient les traites chaque mois. Dans son budget, le poste le plus important est de très loin celui du bistro. Levé entre 7h et 9h, il y petit-déjeune, y bouquine, y donne ses rendez-vous et y travaille. Les horaires sont variables, c’est la caractéristique du métier, on peut faire une séance d’enregistrement de 10h, prendre l’avion à 6h, ou se coucher très tard après un concert. Depuis quelques années, il s’oblige à prendre des vacances, au soleil au bord de la mer : Mirtha est uruguayenne, et Pablo me rappelle que Montevideo est un port. Ces jours-ci, il compose. Il vient de boucler l’intégrale de Gargantua en 8 CD ! Lorsqu’il y a des concerts en perspective, il faut compter 4 heures par jour de travail au zarb pour rester « au top ». Pablo compare notre statut de musicien avec celui des Belges, des Anglais ou des Espagnols sans aucune protection sociale. Les Assedic représentent actuellement 40% de ses revenus, les droits d’auteur restant faibles. Se remémorant l’intéressant rapport de Jean-Pierre Vincent d’il y a dix ans, Pablo relève un effet pervers des Assedic. « Les artistes survivent grâce à un système collectif voire collectiviste, mais ce régime leur permet paradoxalement d’avoir souvent une attitude libérale et de se vivre comme des aventuriers. La réforme ne résout évidemment pas le problème, et même l’accentue, tout en générant d’autres effets pervers. Au-delà de l’aspect bricolage de cette réforme, le plus inquiétant est le choix de réduire le nombre d’indemnisés pour rééquilibrer les comptes (difficulté d’entrer dans le système notamment pour les jeunes). Cela semble indiquer un désir à moyen terme de supprimer notre régime spécifique, contrairement aux affirmations rassurantes voire paternalistes du camarade Aillagon ». Nous descendons au café du coin où Pablo m’offre un verre d’excellent Corneloup (Côte du Rhône). Ce rouge me donne l’idée d’appeler dès le lendemain mon baryton préféré.
Malgré une certaine notoriété, l’année dernière François Corneloup, comme Dominique Pifarély ou d’autres qui ont préféré de ne pas apparaître dans cet article, n’avait pas son nombre d’heures. Ayant déménagé à Bordeaux, ses frais fixes mensuels s’élèvent à 1500 euros pour survivre, 2000 pour travailler. Au-delà, il peut investir dans son orchestre, indispensable pour exister. Il a ainsi financé le disque de son quartet (Ducret Robert Echampard), 6000 euros : être un leader coûte très cher. Il insiste sur l’absence de réseau de diffusion autre que les lieux prestigieux : pas plus d’une dizaine de salles en milieu socioculturel, impossible d’organiser de vraies tournées, les festivals englués dans une problématique de marché sont devenus incompétents ou pas compétitifs…
De passage pour deux jours à Paris où elle loue un petit appartement avec ses deux chats, nourris en son absence par sa concierge, Joëlle Léandre souligne que ce n’est pas la France qui la fait vivre depuis 20 ans ! Inscrite aux Assedic depuis 1973, elle n’a pas touché d’indemnités depuis plus de 18 ans, n’arrivant pas à réunir ses 507 heures. Elle n’a jamais cessé de pointer. Jouer en Suisse, en Allemagne, en Belgique, au Canada, lui assure 70% de ses revenus, modestes cachets pour la plupart. Heureusement, Joëlle pratique la diversité, elle accompagne des poètes, écrit pour la danse et le théâtre, interprète quelques partitions contemporaines, et enseigne 4 mois tous les deux ans au célèbre Mills College près de San Francisco. Toujours en colère, très consciente des luttes, Joëlle s’inquiète pour les jeunes, et pour les vieux dont la retraite approche. Elle aurait bien aimé connaître le sort des quelques dix musiciens qui squattent toutes les scènes et festivals, mais, comme par hasard, ceux-ci préfèrent éviter de figurer dans une telle enquête.
Pendant le retour d’un Conseil d’Administration des Allumés du Jazz qui ont, faute de crédits suffisants, déménagé au Mans (nouvelle politique d’implantation régionale forcément très salutaire), Didier Petit me raconte qu’il part vivre en Bourgogne, à une heure de TGV de Paris (où il conserve un pied-à-terre), pour des raisons de qualité de vie, d’économie, et avec l’envie d’organiser des concerts en régions. Il insiste pour que les artistes s’impliquent beaucoup plus dans la production pour comprendre le milieu dans lequel ils vivent. Il raconte aussi qu’un concert dans un centre culturel français à l’étranger lui fut payé par un chèque de l’Etat (Trésor public) sans aucune feuille de salaire !
Voilà 35 ans que Ann Ballester vit sans savoir de quoi sera fait demain. Elle a créé un outil pour enseigner en toute légalité, l’école associative Musiseine à Marcilly-sur-Seine, en milieu rural, où, dès le début, les élèves jouent autant Bach qu’ils improvisent. Pour ne pas les coincer avec ce mot qui fait peur, elle leur demande d’abord de mettre les notes dans le désordre ! Comme tous les intermittents, n’ayant pas le droit de faire partie du bureau de l’association, elle en est la responsable artistique. « On n’a pas le droit d’être bénévole, mais on est forcé de l’être, car 95% du boulot n’est pas rémunéré, on bosse 7 jours sur 7, avec la journée de 35 heures » ! Ce sont les concerts en trio, en quartet, et surtout avec Archie Shepp et des amateurs (de 50 à 400 !) qui la font vivre. Sans les Assedic, elle ne pourrait pas continuer à payer les traites de sa maison. Pendant 3 ans, elle a « bouffé des patates ». Elle milite activement au sein de l’Union des Musiciens de Jazz, l’UMJ.
Je termine ce petit tour en rendant visite à Serge Adam dans sa maison de Ménilmontant qu’il a achetée il y a 20 ans alors qu’il était prof d’économie, la retapant petit à petit. Il y vit avec sa compagne, l’architecte acousticienne Christine Simonin, et leurs deux enfants. Ayant lu le protocole, Serge s’est fait mal voir en juin dernier pour avoir dénoncé le discours qui s’y opposait sans nuance et fustigé la grève des festivals. Il défendait que le vrai combat était celui de la déconcentration en régions, regrettant que les artistes n’aient pas appuyé en début d’année les revendications des enseignants, comme Pablo Cueco notant de son côté qu’ils n’étaient pas non plus aux manifestations sur les retraites. Serge comprend que le protocole fut un détonateur, d’autant que les groupes de travail, comme la Coordination des Intermittents et Précaires d’Île-de-France, se mirent en place avec une efficacité remarquable. Il se pense comme un privilégié qui bénéficie des allocations chômage depuis 17 ans. Il a toujours travaillé plus d’heures que le minimum demandé. Au début, il acceptait tout, cirque, variétés, zouk, pas seulement du jazz ou des projets créatifs, pour obtenir son compte d’heures. Salaires - commandes plus droits d’auteur et d’interprète (il rappelle qu’il est nécessaire de remplir les feuilles de Spedidam et déclarer les enregistrements sur le site de l’Adami !) et Assedic représentent chacun un tiers de ses revenus. Il joue de la trompette dans trois ou quatre orchestres, et investit le reste de son temps dans la production, avec son label Quoi de Neuf Docteur. Il est plus facile de s’en sortir lorsqu’on a un peu l’esprit d’entreprise ! Il a arrêté de jouer dans les clubs pour pouvoir s’occuper des enfants le matin, il essaie de préserver le dimanche et prend une semaine de vacances tous les deux mois. C’est une lutte quotidienne pour faire vivre ces musiques, il faut monter des dossiers, trouver des partenaires, présenter des projets… C’est la « rame totale » et sans aucun répit, même si la liberté et l’autonomie dont jouissent les musiciens sont enviées par nombreux autres artistes qui, ne pouvant bénéficier du régime des intermittents, doivent, parallèlement, avoir un autre travail pour survivre.
Cela rappelle le statut des musiciens américains, souvent obligés de cumuler les « gigs » ou les emplois pour pouvoir survivre. En France, quelques-uns s’en sortent en enseignant. Il y a quelques années, comme je demandais au responsable de la création à la Direction de la Musique comment les autres musiciens s’en sortaient, il me répondit, cynique et amusé, qu’ils avaient une femme qui travaille, souvent dans l’enseignement d’ailleurs. Tiens donc, le gâchis ça rapproche ! Mais comment font les autres, s’ils ne sont pas soutenus par leur famille ? Ils crèvent la faim, tout simplement, et ils le font en silence.