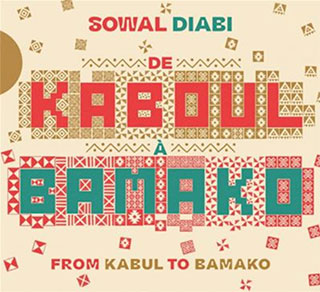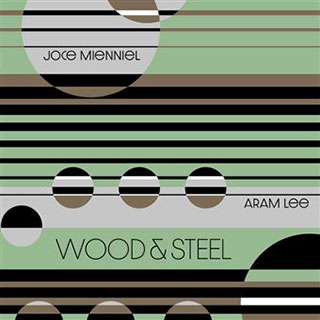Vers la fin des années 60 on parlait beaucoup des prêtres-ouvriers et Colette Magny chantait
Camarade curé. Pour
Le charme discret de la bourgeoisie Buñuel inventa un évêque-jardinier. J'ai l'impression que
Jacques Thollot fut toute sa vie un compositeur-poète, depuis
l'enfant batteur qui jouait en culottes courtes avec les grands du jazz à l'immortel inventeur de formes qui me ravit chaque fois que je réécoute un de ses enregistrements. Le label Souffle Continu ressort (en vinyle et en CD) son deuxième album
Watch Devil Go publié en 1975 par Jef Gilson sur Palm. J'ai beau le connaître pour posséder le vinyle original, je suis encore une fois surpris par son inspiration lyrique. Thollot qui, en plus de la batterie, joue du piano et du synthétiseur, est remarquablement accompagné par
François Jeanneau très aylerien au sax ténor, mais aussi à la flûte et au synthé qu'il a développés au sein du groupe de rock Triangle, ainsi que son acolyte
Jean-François Jenny-Clark à la contrebasse, habitué aux acrobaties contemporaines. Les seize courtes pièces forment un éventail chatoyant dont les couleurs sont rehaussées par la chanteuse afro-américaine Charline Scott sur le morceau éponyme ou par un quatuor à cordes, composé de membres de l'Orchestre de Paris devant déchiffrer les petits bouts de partitions gribouillés, sur
Entre jazz et lombok. L'époque était particulièrement imaginative. Le free jazz se mariait au sérialisme, l'électronique envahissait la pop, offrant aux plus audacieux des champs inexplorés. Après le précédent
Quand le son devient aigu, jeter la girafe à la mer, ce disque est un must absolu. Il démontre que l'on n'est jamais obligé de s'enfermer dans un genre, mais qu'en laissant la porte ouverte à ses rêves les plus intimes, il est possible d'accoucher d'œuvres phares qui embrassent le monde et l'éclairent sous un angle insoupçonné jusqu'alors. Alors qu'aujourd'hui des cathos intégristes font interdire des concerts dans les églises, j'ai forcément une
Sympathy for the devil !
Il y a sept ans, lors de la mort de Jacques Thollot, j'invitai Fantazio et Antonin-Tri Hoang à me rejoindre sur la scène de la Java pour lui rendre
hommage sur un texte de Henri Michaux qu'il aimait particulièrement. C'est encore une nouvelle occasion de republier l'entretien fleuve que Raymond Vurluz et moi avions réalisé fin 2002 avec lui pour le Cours du Temps du n°7 du
Journal des Allumés du Jazz. Il figure également dans le magnifique double CD d'inédits
Thollot In Extenso paru chez nato en 2017.

Héros du free jazz malgré lui, batteur chantant, compositeur la tête
dans les étoiles, Jacques Thollot joue sur tous les temps, les marques
et les démarques. Le dessinateur Siné disait de lui qu’il était le
"poète des drums". Éclipses et résurgences s’enlacent, s’embrassent et
s’embrouillent dans le parcours unique d’un musicien sans pareil. Il
projette les mille éclats d’un chant en quête d’infini, une musique
impressionniste qui cherche à voir, sentir, rêver, comprendre.
Rencontre avec Raymond Vurluz et Jean-Jacques Birgé.
Transcription de Nicolas Oppenot.
Raymond Vurluz – Comment choisis-tu de jouer de la batterie ?
Je faisais une sorte de bande dessinée sur des papiers comme des
rouleaux à chiottes, mais c’était pour imprimer des comptes. Ça allait
dans des machines. Je faisais des immenses histoires, des cirques
interminables. Et dans les cirques, il y avait la fosse d’orchestre qui
était en hauteur. Il y a toujours eu un rapport avec le rouge. Il y a
beaucoup de rouge au cirque. C’était entre le cirque et les Indiens. Je
dessinais beaucoup d’indiens avec des tambours et les fameux boum boum
boum ! Tous ces trucs, ça fascinait. Ce qui m’a carrément illuminé,
c’est les reflets à Tours où j’ai de la famille, par une lucarne de
chez ma cousine couturière Alice, un 14 juillet. Les pompiers
défilaient, avec les tambours au premier plan. Ça m’a achevé, si je peux
dire… J’étais déjà dans un domaine où il y avait tout le temps une
rythmique ou quelque chose de rythmique. J’ai suivi ce qui me plaisait
le mieux et ça a abouti au premier tam-tam, avec des palmiers rouges sur
fond jaune et un ou deux trucs verts, des couleurs qui vont pas du tout
ensemble, et au pochoir, déjà. J’avais sept ans. C’était une époque où
les gens s’invitaient encore beaucoup. À chaque fois qu’il y avait une
soirée à Vaucresson, les gens dansaient et c’était l’occasion, comme la
musique était un peu plus forte que d’habitude, de m’éclater à jouer
derrière les disques.
Jean-Jacques Birgé – Tu passes directement du tam-tam à la batterie ?
Grâce au Père Noël, un ou deux ans après. J’ai vu une photo dans
Marie-Claire où j’ai l’air assez rayonnant avec une cymbale entre les
mains, près d’un sapin de Noël. Alors j’imagine que ça a dévié comme ça
de la peau au métal. Mais bon, ça reste une attirance pour les peaux.
Juste une cymbale, la batterie ça a été un peu plus tard. Vaucresson,
petit pavillon, rue près de la gare, beaucoup de passants, beaucoup de
bruits de percussions sortant de ma fenêtre toujours ouverte. Un jour,
quelqu’un a sonné en proposant une batterie à vendre, parce qu’il a
entendu. Un prix dérisoire, un instrument assez exécrable, mais pour moi
super. Je dis exécrable, c’est même pas vrai, parce que c’était une
grosse-caisse très haute avec des vraies peaux. Je n’en connaissais pas
la valeur, je l’ai larguée dès que j’ai pu pour une plus sophistiquée,
plus brillante.
Ma première batterie, on me l’a amenée comme qui dirait sur un plateau
et maintenant que j’en parle, ça a dû influencer ou conditionner mon
comportement pour ce qui est de vendre mon travail, ce qui est pour moi
une sorte d’aberration. Moins maintenant, on parle de cette époque. Je
trouve qu’avec le temps, la vie c’est à vie, le contrat avec quelque art
que ce soit. Après Cugat, j’ai entendu les premiers enregistrements de
jazz en 78T, pourtant je ne suis pas si croulant ! Vaucresson a
aussi beaucoup compté. C’est une ville que j’aime beaucoup, qui se
transforme, mais bon… Moi aussi, ça tombe bien ! Mais c’est pas les
mêmes résultats.
JJB – Avec ta batterie, tu joues tout seul, à ce moment-là.
La première fois, c’est avec mon frère et quelques-uns uns de ses amis
de son lycée de Saint-Cloud. Le trip orchestre de lycée, salle des
fêtes, premier concert, Nouvelle-Orléans. Petit coup de pouce
médiatique, on a créé un petit déplacement de photographes puisqu’on a
joué à l’enterrement de Sidney Bechet à Garches, alors qu’on avait fait
la demande et qu’ils nous l’avaient interdit. Ça s’est su alors on a
remis le coup un jour après. On a fait le mur et on a été jouer sur sa
tombe. Sidney, c’est Garches qui est à trois kilomètres de Vaucresson.
J’étais relativement bien encadré par le hasard.
JJB – Que se passe-t-il après le groupe avec les potes de ton frère ?
Quelques répétitions, dont les premières avec un orchestre
Nouvelle-Orléans. J’étais encore môme. Les premières répétitions à
Paris, à bouger mon matériel. Faut connaître, faut être prévenu, avec la
batterie… Je me rappellerai toute ma vie de l’erreur de dialectique
chez le trompettiste qui habitait rue de la Fontaine aux Rois, pas très
loin de République. Il tenait à l’époque un bazar, un marchand de
couleurs qu’ils appelaient une droguerie. Alors comme on m’avait déjà
fait des plans, on m’avait fait peur avec des fausses seringues, j’y
voyais une fumerie d’opium – en plus c’était dans la cave les
répétitions. J’y suis allé avec la peur et j’en suis sorti ravi. C’était
effectivement une droguerie. Pas comme je l’entendais, quoi !
RV – Tu connaissais déjà le be-bop ?
Justement, c’est incroyable, c’est presque une chronologie de
dictionnaire musical. À la fin des six mois, j’ai entendu le middle
jazz. J’entends par entendre que je comprenais de quoi c’était composé.
Le be-bop, je l’ai adoré très vite aussi parce que c’était moderne. Je
crois que dans les premières choses be-bop que j’ai jouées, il y a un
morceau de Cannonball Adderley, à trois temps, déjà (je suis très
ternaire). L’orchestre avait changé de physionomie. Il y avait toujours
mon frère, mais il y avait la fille des chapeaux Orcelles, Catherine
Orcelles, qui jouait du piano. Jean-François Jenny-Clark, déjà, à seize
ans. C’est incroyable. J’ai des photos du premier gig, un concours au
Salon de l’Enfance et on a joué ce morceau quasi be-bop. C’était le pied
!
RV – Y avait-il des musiciens professionnels à Vaucresson ?
Oui, Gérard Dave Pochonet, chez qui j’ai écouté les premiers 78T de jazz
qui sortaient. C’était assez exceptionnel : Sarah Vaughan, avec
des instrumentistes super. Vaucresson est dans une sorte de creux et il y
a un plateau qui a toute sa dose de mystère. Je me rappelle qu’il
voyait des Américains dans les arbres. Ça me donnait aussi un autre
aperçu du jazz. Vraiment, il les voyait en train de plier leurs
parachutes, avec moultes détails.
RV – Te souviens-tu de ton premier engagement professionnel ?
Oh ! Je n’avais jamais pensé à ça. Je me suis retrouvé dans une
grande école vers la montagne Ste Geneviève, Polytechnique. C’était le
premier contact avec beaucoup de gens, vraiment super… Le vrai gig, dans
le sens plein (parce qu’un endroit approprié au jazz), c’est au Club St
Germain.
RV – – Il y a une interview de toi à la télévision. Tu es petit. Tu
cites même Max Roach. Ça se passe au Club St Germain. On voit à tes
côtés Mac Kack, Bernard Vitet. Il y a aussi Bud Powell avec Kenny
Clarke…
J’ai d’excellents souvenirs musicaux, mais moins de rapports humains.
J’étais tellement content de jouer là que je m’en foutais. Mac Kack me
traitait un peu bizarrement. Ça faisait rire qui voulait bien avoir ses
grâces. Vu qu’il vivait avec la patronne du club, chaque fois qu’il me
présentait il se foutait de ma gueule pour peut-être combler certains
manques dans sa spécialité, une image gai luron de mec, " Qui n’a pas
une histoire avec Mac Kack ? ", soit qu’il pisse sur un flic en
discutant avec lui, toutes sortes de trucs comme ça… C’était pas
vraiment méchant, c’était rien, mais bon, ça me faisait un peu de peine,
quand même. Il y avait tellement d’autres satisfactions… Bernard Vitet,
est un des premiers musiciens avec qui j’ai joué professionnellement.
On apprend des choses fondamentales avec des musiciens comme ça. Une des
premières remarques judicieuses sur mon jeu, c’est lui qui l’a faite.
On jouait à l’époque Night in Tunisia tous les dimanches. Il y a un
break en syncope et moi je le faisais sur le temps : Kalin KIN
dingueDIN dingueDIN DIN ! ! En fait ça faisait TA PON. Babar m’a
fait remarquer ça et c’était une vraie découverte, parce que j’étais mal
à l’aise dans ce passage mais je ne savais pas pourquoi. Je
n’anticipais pas le break. C’était super de me le dire parce que je ne
pense pas avoir refait la même connerie. Je les ai entendues maintes et
maintes fois, par contre !
JJB – Comment s’est faite la rencontre avec Kenny Clarke ?
Il s’est proposé… J’allais seul jouer dans les bœufs avec mon père qui
m’emmenait, c’était avant mon premier gig, presque. Kenny passait
souvent au Club St Germain. Un jour que j’y jouais, il est allé voir mon
père. Par chance, parce que j’étais un timide redoutable. Kenny lui a
dit que ce serait bien que j’aie quelques notions de base, parce que je
n’en avais pas. C’était tout en autodidacte derrière les disques. Très
bien d’ailleurs de jouer derrière les disques ! La moindre faute de
tempo, ça casse la baraque ! Les pierres se décèlent, les termites
voraces apparaissent et les éléments attendent qu’on leur ouvre la
porte. Rendez-vous a été pris pour que je vienne prendre des cours avec
Kenny au Blue Note, rue d’Artois. C’était l’endroit de Paris où il n’y
avait que des Américains, des gens assez extraordinaires. Parmi eux j’ai
rencontré Bud Powell, il m’a énormément impressionné.
JJB – Que t’a appris Kenny Clarke ?
Tout ce que je ne savais pas et il a confirmé certaines choses que je
vivais. Le lycée s’est terminé de façon lamentable. J’y allais les mains
dans les poches. Je n’avais même pas un crayon, pas de cahier, rien.
Une des choses que m’a dite Kenny, c’est de vivre la musique. Je me
rappelle qu’il m’a surtout appris à jouer de la caisse claire. Il y a
des choses plus tard que j’ai regretté de ne pas lui avoir demandées. Je
ne sais pas s’il a des fils, mais je sentais quelque chose d’un peu
extra dans ses motivations de me filer des cours. Au bout de six mois,
Kenny m’a pris comme remplaçant au sein du Blue Note. Il travaillait
beaucoup, avec Francis Boland, des choses plus ou moins intéressantes,
en Europe, aux US… Alors il travaillait à l’extérieur et moi je jouais.
C’était en parallèle aux cours qu’il me donnait. Je pouvais les mettre
sur le tapis le soir même. C’était vraiment dingue !
RV – C’était perturbant la fréquentation des clubs, pour un enfant ?
J’ai vite eu un abord des choses du sexe très direct. Je me suis
retrouvé à Juan-les-Pins à accompagner des strip-teases. C’étaient quand
même des petits gigs en passant. Je me rappelle que je devais jouer des
mailloches pendant des scènes de matelas, qui me dépassaient un peu. Je
voyais des bonnes femmes se gouinasser, des trucs avec les cris, les
machins. Ça restait très mystérieux, mais je trouvais que les mailloches
allaient bien avec la lumière rouge, l'ambiance feutrée. Un soir, tout
l’orchestre de Count Basie est venu faire le bœuf. Ça a annihilé les
effets un peu bizarres de mon approche des choses de l’amour. À Paris,
j’allais me balader pendant une pause sur les Champs Elysées et quelques
fois je me faisais ramener par des flics au Blue Note qui venaient
demander si c’est vrai que j’étais musicien ! Comme j’étais plutôt
mignon petit garçon, ils s’inquiétaient parce que je me faisais souvent
accoster par des gens qui me demandaient " c’est combien ? ". Et
moi je ne sentais pas ça. J’ai commencé à apprendre quelques injures à
cette époque, pour être tranquille.
JJB – Tu as été confronté à l’alcool, à la drogue, du fait de vivre dans ce monde d’adultes…
Je suis tout de suite tombé dans des chiottes aux portes ouvertes où les
gens se shootaient gaiement, voir plus d’ailleurs, des scènes
incroyables. La boisson pour moi, c’était une sorte de tragédie vécue en
la personne de Bud Powell… Il ne parlait presque pas, je ne parlais pas
anglais, mais je comprenais et je pouvais baragouiner… Je le voyais
tout le temps supplier, pleurer auprès du patron, Ben, pour avoir une
mousse, un truc, un machin, et moi je ne me rendais pas vraiment compte
des ravages de ces substances, sinon que Bud quelques fois s’endormait
au piano. Il était comme ça, on ne savait pas si c’était une extase
intérieure ou un mal-être ou les deux… Je voyais ce musicien
extraordinaire, avec un sourire de contentement parce que j’avais fait
un truc peut-être joli ou quoi. De Bud, c’est magique ! Je ne
comprenais pas bien ce que venait foutre le patron qui lui interdisait
de boire. Il allait boire ailleurs… Il y avait aussi un hôtel un peu
mythique. C’était pas le Chelsea Hôtel, mais c’était en face du
Caméléon, rue St André des Arts et tous les musiciens étaient logés là,
tous ceux qui venaient à Paris par Marcel Romano. J’y ai croisé des gens
comme Thelonious Monk, plein de gens incroyables et j’ai vu aussi des
drames. Il y avait un bassiste américain, Oscar Petitford. Moi je venais
le matin aux nouvelles parce que Romano qui faisait venir des
Américains s’était intéressé aussi à une éventuelle façon de faire du
pognon avec moi, avec l’âge et la musique que je faisais. J’ai vu
presque mourir des gens en rapport direct avec la boisson. Ce bassiste,
ça me frappait parce qu’à l’heure où tout le monde prend son
petit-déjeuner, il avait un bol mais c’était du cognac, à raz bord. Il
lui fallait ça pour simplement sortir du lit, sans doute. Ça ne m’a pas
profondément choqué puisque j’ai été confronté à des passages difficiles
aussi. Et du coup, la fumée… Les gens fumaient dans les portes
cochères, en se planquant, avec presque une paranoïa cultivée.
Contrairement à ce que je croyais, ils ne devenaient ni meilleurs ni
marrants. C’était de la merde. Je me suis aperçu après que ce n’est pas
évident de trouver des bonnes choses ! C’était plutôt tristesse,
planque, paranoïa, alors qu’après, j’ai eu l’occasion de fumer ces
substances tout à fait naturelles pour le moins. Quand je suis allé en
Afrique, j’ai découvert le bangui à Bangui. On demandait aux garçons
d’ascenseur un petit pétard et ils revenaient dans la seconde avec un
sac en plastique rempli d’herbe, une des choses pour moi les meilleures
au monde. Contrairement à l’idée que j’avais eue sur la fumée parisienne
et paranoïaque, là j’ai découvert une explosion de rires, de bien-être…
Il faut dire que c’était dans le contexte, au soleil… Le premier joint
ça a été waou… J’en ai loupé un avion parce que j’étais écroulé de rire
devant des fourmis sur la table de l’aéroport ! Les fous rires
c’est rien, ça me coinçait partout. Les fourmis, je ne sais pas ce
qu’elles faisaient mais c’était tout un scénario abracadabrant et bon,
il est vrai que c’est un des seuls produits qu’il m’arrive de consommer
si je veux bien mettre l’alcool du côté des accidents.
RV – Cette époque est aussi marquée par l’ambiance générale de la guerre d’Algérie ?
La guerre d’Algérie, il y avait plein de personnes qui étaient contre.
C’était normal. J’ai vu mon frère y partir, quelques amis qui ne sont
pas revenus, mais la véritable approche politique, la prise de position,
ça a été un peu plus tard, juste avant l’indépendance où là je devenais
presque actif dans mes convictions d’indépendance. Par le jazz, j’ai
été amené à rencontrer Siné, qui à l’époque était menacé physiquement,
et je me rappelle de choses assez folles. J’allais manifester, avec mes
peu de moyens… Il était question que Salan débarque en avion avec les
parachutes. Des soirs avec une tension pas possible, on ne savait pas si
c’était du lard ou du cochon, tout le monde était mobilisé. Je jouais
au Chat Qui Pêche, et là-bas il y avait une bouche d’aération, juste
au-dessus de la batterie, qui donnait sur le trottoir. J’ai eu les
jetons de voir une bombe valdinguer par ce truc-là. Il y en a qui
bougent, que ça touche de près ou de loin et il y en a qui restent
indifférents, qui s’occupent de leur propre devenir, comme s’ils étaient
seuls au monde, au fond. Je n’ai eu que très rarement de discussions
politiques ou d’opinion avec des musiciens français, hormis François
Tusques. Les premières choses que j’ai faites avec lui, c’est à Nantes.
Là-bas je voyais des choses que je ne voyais pas à Paris, des réunions
après des concerts où il était question justement des problèmes soulevés
par les confettis de l’empire, comme disait je ne sais plus qui. Je
trouve intéressantes ces discussions dans un milieu qui a priori n’a pas
grand-chose à voir, sinon que c’est un moyen d’expression qui peut être
communicatif, c’est une responsabilité, même pas… Une conscience.
RV – Te souviens-tu du premier contact avec le free jazz ?
Ça n’a pas été un coup de massue. Comme on avance dans la vie et qu’on
suit ses instincts et son début d’éthique, ce sont des personnes qui
pensent un peu les mêmes choses qui se rencontrent. Les rencontres,
elles se font aussi comme ça, pas seulement parce qu’on entend quelqu’un
qui joue bien… Parmi les quelques disques auxquels j’ai participé, je
tiens assez à celui qu’on a fait à Rome avec Steve Lacy, “Moon”. Steve
croit qu’il n’y a que dans cette séance que je joue comme ça, je sais
qu’il aimait bien. Faut dire que Rome c’est inspirant. Après ça j’ai
fait des expériences, des chansonnettes, il m’a dit " quand tu finiras
de faire de la merde ", d’une façon pas indélicate. Je tentais quelque
chose, c’était pas du tout évident et son jugement ne m’a pas été du
tout inutile. On ne fait pas de la chansonnette comme ça… Faut être né
sans le reste pour en faire… Disons que ce qu’on appelle le free jazz,
pour moi c’est un peu comme en peinture, une reconnaissance d’un bagage
énorme de choses de qualité, dans un style donné. Des choses tellement
énormes à réunir pour qu’un individu maintenant fasse, dans ce style,
quelque chose d’extrêmement intéressant. Dans mon abord du free jazz, il
n’y a pas seulement les Eldridge Cleaver, les Black Panthers… Ben il y a
tout ce qu’il y a, de Charlie Parker aux plus récents, des choses
tellement magnifiques que je me vois mal repasser dans leurs sillons et
amener quelque chose d’encore mieux que ce qui a été fait, dans cette
esthétique-là. À l’époque, c’était effectivement free, un truc de
liberté, repousser les barrières qui d’habitude sont plutôt salutaires
pour les expressions. Je ne ressens pas le free jazz comme un mouvement
définitif. Je trouve qu’il est très bien, sa durée, tout ça…
RV – Le passage avec Eric Dolphy, c’est un moment important pour toi …
Je me rappelle surtout de Donald Byrd parce qu’il m’a appris une chose
essentielle à la batterie. Je trouve ça super d’ailleurs, parce qu’il me
voyait vraiment souffrir à jouer des tempos extrêmement rapides. Parce
que le " chabada " je le jouais en entier… Tin ti gui ding ti gui ding
ti gui ding… Ce qui est pratiquement impossible à faire si c’est sur un
tempo des plus rapides. En plein concert il voit que j’ai vraiment du
mal à tenir, alors il prend une baguette et tchac, il fait comme ça,
comme un petit secret : " regarde ! ". Il laisse rebondir la
baguette sur la cymbale… De cette seconde-là, je joue exactement pareil
les tempos hyper rapides, c’est-à-dire que je ne marque pas le dernier,
je marque sur la main gauche… Je donne bien le coup pour en faire
trois ! C’est un détail qu’on aurait pu m’apprendre dans des
milieux plus avisés que la trompette, mais enfin… C’est fou les progrès
que j’ai faits juste en laissant rebondir la baguette ! Donald
Byrd, un type adorable. Au début, en rigolant, il me disait " mais ça va
venir " parce que je voulais garder le tempo et il me montrait son
petit doigt et je comprenais pas trop. J’ai vite compris qu’il voulait
parler de " il faut en avoir pour garder le tempo ". Du jour au
lendemain, avec les défilés qu’il y avait, il a vu qu’il n’y avait aucun
problème, j’avais un tempo correct.
JJB – Dolphy ne t’aurait-il pas influencé sur ta manière d’écrire ?
Dolphy a été un des rares, à part des gens plus techniques de l’époque, à jouer des écarts qu’on trouvait surtout dans la musique de douze sons… Dès que je l’ai entendu jouer, j’ai été frappé par cette voie très personnelle, ces intervalles de quarte augmentée, de
septième, sans arrêt, des trucs… Et cependant des phrases extrêmement
belles et tout à fait dans les accords. Il confirmait cette idée que
j’ai aussi de la mélodie qui peut très bien sortir des écarts ou des
choses qu’on disait faux. Comme quand, môme, j’ai fait un bref passage
aux Beaux-Arts, on interdisait de mettre du bleu et du vert à côté, ou
du rouge et du jaune à côté. C’est les plus beaux trucs de la peinture.
RV – Comment as-tu rencontré Don Cherry ?
Parmi les lions. Pas les mi-lions mais les lions bien entiers. Je crois
me rappeler que c’est une histoire de cravate aussi. C’est une époque où
j’achetais mes cravates aux Puces, avec d’autres trucs marrants qu’on
trouvait là-bas et qu’on trouvait pas ailleurs. Toute sa vie il m’a
parlé de la première fois où il m’a vu avec une cravate qu’il trouvait
insensée. Ça me semble absolument naturel parce que j’ai vu après qu’on
avait beaucoup de similitude dans ce qu’on aimait, pictural ou
esthétique. C’est fou ça. Il manque encore plus qu’il n’a apporté. C’est
vraiment un cas… Don ça me fait vraiment autre chose, même une photo…
RV – Est-ce qu’à Heidelberg, avec tous ces gens, tu avais l’idée de
démarrer quelque chose qui te serait plus personnel, un orchestre par
exemple ?
Je faisais des rêves d’orchestration, hors batterie. C’est encore Don
qui m’a conseillé de faire ma musique. C’est lui qui m’a dirigé.
JJB – Quand tu joues, pas très longtemps après, Our Meanings and our Feelings
, dans quel cas de figure es-tu ?
Comme un passager. J’ai gardé mes bagages. C’était le plaisir de faire quelque chose avec Portal.
RV – Tu fais un disque aussi avec Sonny Sharrock, en trio, un disque free…
Pour ma part, sans inspiration véritable. Pour Sonny Sharrock, je suis
revenu de Munich en avion, juste pour une séance l’après-midi, et il se
trouve qu’à Münich, il y avait une spécialité, à l’époque, qui
s’appelait le LSD. J’ai fait ce disque, paraît-il, dans ces conditions.
Je l’avais rencontré avec Herbie Mann. Moi j’étais avec Joachim et Eje
Thelin. C’était puissant. Il se trouve que c’est un des soirs dont je me
rappelle encore, un des soirs magiques où on joue le mieux qu’on n’a
jamais joué et se demande si on rejouera jamais aussi bien un jour.
RV – Il y avait aussi des choses très expérimentales, par exemple ce duo avec Eddy Gaumont qui s’appelait…
… Intra Musique. Enfin, oui c’était pas le duo qui s’appelait comme ça,
c’était carrément un mouvement. On voulait devancer les critiques pour
donner un nom au mouvement. Il n’y a eu qu’un seul concert d’intra
Musique, à la Faculté de Droit. C’était dans la continuité de l’idée que
j’avais de la composition, de la forme, un certain classicisme. Eddy
Gaumont aurait sûrement été le musicien du siècle. L’ambiance de
l’époque et la façon de mener sa propre vie ont fait qu’il s’est
supprimé. La pureté enfantine et la conscience d’un adulte. Ça n’a pas
du tout marché. Le peu de tentatives qu’il a expérimentées, ça a été
très mal reçu et il faut dire que lui-même était devenu très vite
agressif. Pour pas en recevoir plein la gueule, il dégainait avant.
C’est le cas de le dire, parce que pour une mauvaise parole, un jour en
Belgique, il a sorti son rasoir qu’il avait tout le temps sur lui et il a
balafré un musicien belge qui avait de belge une manie encore assez
récente d’avoir des colonies…
RV – Peu de temps après, tu enregistres Quand le son devient aigu, jeter la girafe à la mer.
C’était le début et même la continuité du début, parce que dans
La Girafe,
il y a des motifs qui dataient de dix ans avant, que j’avais trouvés
sur des bandes à moitié cramées. C’était hors temps, cette musique-là
que je faisais parallèlement à toutes les expériences… Parce qu’il m’est
arrivé de jouer free pour le cacheton, ce qui semble assez
extraordinaire ! D’autres faisaient des séances d’enregistrement
avec des chanteurs yéyé et moi j’avais le free jazz.
RV –Sur cette décennie-là, il y a quatre disques qui sortent, quand même : La Girafe, Watch Devil Go, Résurgence
et Cinq Hops.
François Jeanneau vole dans ce disque. C’est fou. La chanteuse Elise
Ross disait : " je donnerais toute ma vie pour pouvoir faire ce que
vient de faire François ! ". Après
La Girafe, c’est un creux de vague,
Watch Devil Go.
Il est question du diable, quelques rechutes assez longues dans le
temps, des rechutes psychologiques, suivies de tas de choses contraires à
la réalisation de la musique. Pour y arriver, je n’ai pas fait de surf.
Parce que ça allait plutôt vers le grand large, que vers la côte
ensoleillée !
Watch Devil Go, peut-être le coup de pied au fond de la piscine pour remonter à temps et pouvoir respirer.
RV –Il y a ce concert assez extravagant à Nîmes où Weather Report
supprime sa première partie, tu te retrouves le lendemain en première
partie de Stan Getz. Stan Getz ne vient pas et tu deviens LE gros succès
du festival de Nîmes 1979.
Le son était très bon et c’est peut-être une des seules fois où j’ai pu
entendre complètement ce qui se passait sur scène et en quelque sorte le
maîtriser aussi.
RV – As-tu pensé que ce que tu cherchais à faire était difficile à atteindre avec les musiciens choisis ?
C’est comme les systèmes solaires, je suis sûr qu’il y en a d’autres,
d’autres bons musiciens que nos chers défunts. Je crois qu’au point de
vue feeling, ça intéressait justement les pianistes… Une technique
d’écriture pas très conventionnelle, des doigtés qui sont adaptés au
rythme.
JJB – Tu as vraiment eu l’impression d’avoir arrêté de jouer dans les années 80…
Je ne pouvais pas supporter de ne travailler que pour les oiseaux, bien qu’on s’entende très bien...
JJB – Il y a eu le disque de Berrocal.
C’était super. J’aimais bien ne pas être leader, ne pas avoir cette
responsabilité. Parfois même, certaines personnes me disaient (et ça ne
me faisait pas très plaisir) que je jouais mieux avec d’autres groupes
qu’avec le mien, ce qui doit arriver immanquablement. Et puis il y a eu
Winter’s Tale
que j’ai ressenti comme un coup de main… Ça n’était pas évident. J’aime
bien ce disque pour diverses raisons, dont la reprise de contact.
JJB – Qui en fait amène à Tenga Niña.
Il me redonne envie de jouer, je recrois un peu en ce que je fais et
pourquoi je le fais. Ça a marqué, parce que s’il n’y avait pas
Tenga Niña, je ne serais pas là maintenant, je n’aurais pas cherché, quoi.
Je ne sais plus ce qu’on raconte là… C’est comme du présent… On va
bientôt se croiser, justement : " Hello ! Comment tu vas
toi ? ". Je crois qu’à un moment de sa vie, on se croise.
PORTRAITS-SOUVENIRS
René Thomas
Je lui en ai tellement fait voir… J'ai par exemple brûlé une armoire
d'hôtel dans sa baignoire, juste avant qu'il ne rentre dans sa chambre.
Il a toujours eu besoin de certaines choses, René ; la même journée
j'avais demandé à deux mecs sur le port de Palerme de faire comme si
c'était des flics et d'aller se saisir de l'individu à grosses lunettes
qui sortait de l'hôtel. Et les mecs y sont allés, en faisant semblant
d'être de la police alors René a commencé à se rouler par terre… Je le
croyais assez sérieux, les premiers jours où je l'ai connu chez Popol à
Bruxelles. Il avait un air, comme ça, un peu extraordinaire, d'un autre
monde. Je jouais avec René, avec beaucoup de plaisir. Au bar de chez
Popol, d'un seul coup, il s'écroule par terre, comme si on avait
débranché l'électricité, vraiment, une chute formidable. En fait, il y
avait une fille qui était assise en amazone sur un siège de bar et de là
où il était tombé, il voyait absolument tous les dessous de la fille…
En fait, il a fait exprès de tomber pour mater la fille, comme ça. Des
milliers de choses avec René Thomas… L'ambiance à 6 heures du soir dans
une semi-brume belge où il jouait "Theme for Freddy ", comme ça, sans
que l'on ait répété. J'avais les larmes aux yeux.
Karl Berger
C'est énorme. On a partagé le plaisir de faire des tournées avec Don
Cherry et c'est un des orchestres où je me suis le plus éclaté de ma
vie. C'est aussi, pour moi, une vie, Karl : Heidelberg, qui reste à
ce jour la ville où j'ai vécu de façon la plus en symbiose avec tout ce
que je pouvais espérer de la vie. Et Dieu sait si j'en attendais !
C'est fou ! De Heidelberg, je prenais des avions, juste pour
ramener des petites Allemandes à Vaucresson, pour les voir d'un peu plus
près pendant trois quatre jours ! Incroyable ! Et pour Karl,
c'était la terreur, ça criait toutes les nuits dans sa maison, les
gémissements… Oh j'ai refait le coup à Rome avec Steve Lacy. À la fin,
je me suis fait virer de chez eux.
Aldo Romano
Des coups justes, un feeling très développé. Je crois que je n'ai jamais
entendu Aldo ne pas bien jouer. Je n'étais peut-être pas là où il
fallait ?!
Jean-François Jenny-Clark
Oh, La Corse ! Le souvenir de ces premières autres formes de gig
qui consistait à jouer pour gagner un peu de pognon et passer des
vacances. On jouait des saisons en Corse, dans des clubs genre
Méditerranée. Ce sont des moments presque aussi sublimes que les autres.
On était très proches avec JF, on se faisait trois kilomètres de plage
pour aller bouffer une glace à Calvi. Et puis des séances photo, lui me
poussant dans une poussette de bébé, sur une fenêtre d'une maison
délabrée à Calvi. Tout ça, ce sont des noms qui en premier me font
réagir avec bonheur. Tellement à dire…
Joachim Kühn
Le meilleur n'a pas été fixé sur disque et je le regrette parce qu'il y a
eu des moments de live qui auraient mérité d'être fixés mille fois plus
que certains disques qui justement étaient un peu prisonniers du free
jazz, ce qui peut sembler paradoxal. Joachim avait envie de jouer des
choses formelles. Ça sortait dès qu'il le pouvait… Une marche ou quelque
chose pris avec dérision, une dérision pudique pour ne pas trahir le
free jazz. On se retrouvait à simuler des choses formelles d'une façon
un peu dérisoire.
Pharoah Sanders
Une frustration. N'avoir joué qu'une répétition, à Berlin, et un concert
avec lui. Tellement saisi d'entendre ce que j'aimais écouter sur
disque, des choses directes, différentes. Moi je pensais qu'il ferait le
disque (Eternal Rhythm) aussi, donc je n'étais pas si triste et puis
après, ça m'a fait vraiment chier qu'il n'y soit pas. Sentiment d'une
belle intelligence.
Barney Wilen
Ça m'évoque tellement de choses, Barney. Je crois que c'est le musicien
avec qui j'ai joué le plus longtemps et nos voies se rejoignaient,
peut-être même sur des malentendus, ce qui peut soutenir quelque chose,
parfois. C'était pas le cas pour tout, mais disons peut-être dans une
différence de façon de vivre. Je vais merder, c'est trop… Un de ces
soirs, après les sets, j'ai vu Barney prendre la forme de l'escalier qui
descendait au Requin Chagrin, comme un Tex Avery, avec le cou, les
marches… Il était tellement raide qu'on l'a porté jusqu'au premier
étage, sur le lit, avec toujours la forme de l'escalier. Et voilà :
"Barney, bonne nuit, à demain."
Bernard Vitet
Mes débuts dans le jazz, le Club St Germain, les professionnels. Sa
femme était jalouse parce qu'il y avait des cheveux blonds dans son
peigne. Il me logeait très souvent chez lui, quand je ne pouvais pas
rentrer en banlieue par le train et ça faisait des histoires pas
possibles, parce que j'avais des cheveux blonds et un peu longs. Ça
n'était pas les cheveux d'une belle scandinave, ça n'était que
moi ! Une certaine sécurité, aussi, c'est un des premiers un peu
complice dans le monde du jazz adulte. Il me parlait plus que les autres
et m'a même donné quelques conseils. Il me rappelle mes débuts. Je ne
sais pas si c'est gentil ou pas gentil, mais comme je n'ai pas de notion
du temps… Elle se fabrique, la mémoire. Elle s'auto-gère.
François Tusques
Son côté déjà un peu politisé ! C'est un peu aussi un des éléments
de l'image que je me fais des premières rencontres avec François,
d'entendre des musiciens parler politique, carrément. Qui plus est, avec
des opinions particulières, qui correspondaient un peu aux miennes qui
n'étaient pas néanmoins écrites en lettres de feu. Ce n'est pas sous le
nom d'une idée qu'une musique va se faire, mais elle en tient forcément
compte, elle en fait forcément partie.
Beb Guérin
Beb, c'est déjà cette assise musicale. C'est le bassiste avec qui j'ai
pu oublier la notion du tempo, parce que très physiologique. Je pense
aussi à l'amitié. J'ai des petites lumières… Par exemple, un jour je
suis convoqué au Palais de Justice de Paris, j'avais un peu… Chambre 11,
enfin correctionnelle, mais pour des faits tout à fait honorables, et
Beb s'est tout de suite proposé de m'accompagner là à 8h du matin, tu
vois, enfin des choses pour nous presque indécentes. Tout ça avec le
naturel, le senti, sans que je lui demande rien. Un sens de l'amitié,
comme s'il y avait un don pour certaines choses.
Bernard Lubat
Je ne me rappelle plus quand je l'ai vu la première fois, comme si je le
connaissais un peu d'avant, en fait. J'étais assez admiratif envers
Lubat, parce j'étais presque complètement autodidacte et je trouvais ça
incroyable de pouvoir lire les partitions de batterie. Je savais que
Bernard faisait des séances, il pouvait faire ça et il le faisait… Il
gagnait du pognon d'une façon plutôt agréable, parce que c'est quand
même l'instrument… Enfin, je sais pas, c'est pas si pénible que ça,
quoi. Et je pense à Orgeval. C'est un endroit où j'ai vu Lubat hors
contexte. C'est tout bonus. Je dirais même parfois que le contexte
pourrait cacher des choses, qu'il ne révèle pas forcément tout, disons…
Je ne le connais pas si bien comme batteur, Bernard, c'est fou !
Évidemment parce que… j'ai le souvenir qu'on a joué une fois en trio et
ça s'est produit qu'une seule fois dans notre vie, où il jouait du piano
avec Beb à la contrebasse. On a souvent joué dans les mêmes endroits,
sans forcément s'entendre. Parfois on vient juste pour le jour où on
joue… Je ne l'ai pas assez entendu, Lubat, je regrette.
Jacques Pelzer
Il a plus ou moins participé au fait que j'aille en Afrique. Je l'en remercie.
Jean-Luc Ponty
Je me rappelle d'un concert, à la Locomotive. Il se voulait assez
Coltranien et moi ça avait suffi à me brancher sur une façon de jouer…
J'aimais tellement Elvin Jones. Je me rappelle aussi d'une valse de Jef
Gilson à une époque où il y avait Jean-Luc, qui s'appelait " Java for
Raspail ". Un morceau que je trouve très bien. Écrit par Gilson et qui
allait fort bien à Jean-Luc.
Michel Potage
Au début où je l'ai connu, il faisait partie de la grande déconnade.
C'était un peu faire la foire… Pas qu'un peu, même. Après j'ai eu
l'occasion de voir ce qu'il faisait, à part la foire. J'ai ressenti une
écriture originale… C'est pas une question de droit d'exister, non
c'est pas la permission : "est-ce que je peux exister ? Ô
beautés universelles !". L'alcool le rend con, comme tous… Je suis le
premier à être bien placé pour le savoir… J'aime bien ce que fait
Potage.
Gato Barbieri
J'ai bien connu sa femme, adorable, mais j'ai peu eu l'occasion de
parler avec lui… À chaque fois qu'on a joué c'était une super
impression, un son original. Je regrette… Non, je ne regrette rien, mais
j'aurais bien aimé le connaître un peu plus.
Joseph Dejean
J'espère qu'on se rappelle de lui à la hauteur de ce qu'il a pu donner
avant de disparaître. Le souvenir d'un sentiment de conviction d'une
direction existante, de quelque chose de vrai. C'était épatant. C'est
carrément une autre approche de la guitare et pas des moindres.
Kent Carter
Un sens de la musique extraordinaire. Il faisait partie du New York
Total Music Company de Don Cherry. On a fait beaucoup de pays ensemble…
C'est complètement fou tout ce qu'il y a comme musique et esthétique
dans sa tête. Je ne sais pas si la contrebasse est assez large pour
exprimer tout ça. Il faisait des batteries avec tout ce qui lui tombait
sous la main. Il y avait peut-être deux cents objets. Pendant des jours,
il était là, il jouait… Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Je crois qu'à
n'importe quel moment de la journée, on pouvait rentrer, disparaître,
revenir, et la qualité était toujours là, comme un acquis, comme
respirer. C'est extraordinaire.
Peter Brötzmann
J'ai joué avec lui et j'ai fait ce que j'ai pu au début pour qu'il
puisse venir en France. Personne n'en voulait. Je ne sais pas si ça veut
dire quelque chose : intègre… Mais pendant les années où je l'ai
entendu, il ne changeait pas de direction, donc il progressait… Quoique
on peut progresser sur plusieurs parallèles, mais enfin, une seule
direction, ça risque de concentrer le rapport à exprimer… Et lycée de
Versailles !
Tony Hymas
On a eu des moments de communion, des moments extrêmes… Quelqu'un d'une
grande richesse musicale… On a peut-être d'autres choses à partager que
des premières fois.
Sam Rivers
Tout un feeling, une façon d'être, de bouger, d'être proche des
fondations, des origines de la musique qu'on pratique. Là, on parle du
niveau d'une créativité en rapport avec le jazz. J'aime la compagnie de
personnes de couleur et de chaleur… Je n'aime pas trop le jazz trop
blanc, par exemple, puisqu'on est amené à parler des contrastes, qui
existent surtout sur le papier photo, d'ailleurs !
Marie Thollot
Ma Papuce
Ma Vouvoute
Mon Yéyan
Et mon Tilala
Discographie sélective
Indispensables :
Quand le son devient aigu, jeter la girafe à la mer et
Watch Devil Go, Souffle Continu
Rééditions CD incontournables : Don Cherry
Eternal rhythm, MPS 15204ST, POCJ-2520
Cinq Hops, Orkhêstra
Scandaleusement non réédité : Barney Wilen
Zodiac, Vogue Clvlx
Disponibles également aux ADJ :
Jacques Thollot
Tenga Niña, nato - 777 701
Jac Berrocal
La nuit est au courant, in situ - IS040
et paru depuis, en 2017 (Jacques Thollot est
décédé le 2 octobre 2014),
Thollot In Extenso, double CD nato 5484