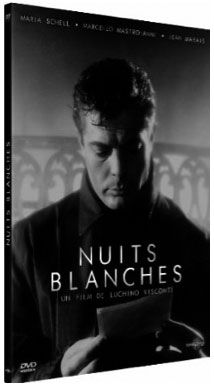vendredi 31 mars 2023
Hi-han (Eo)
Par Jean-Jacques Birgé,
vendredi 31 mars 2023 à 00:05 :: Cinéma & DVD

Comment se fait-il que je ne parle pas du film Eo dans cette colonne alors j'en rabats les oreilles de tous mes ami/e/s ? Quel âne ! Peut-être parce que je chronique plus facilement des DVD/Blu-Ray que les sorties sen salle... Si Pacifiction et Triangle of Sadness (Sans filtre), qui m'ont beaucoup plu, créent la polémique et divisent mon entourage, le film de Jerzy Skolimowski allume les yeux de tous ceux et celles qui l'ont vu. Les chefs d'œuvre sont parfois voués à la clandestinité, au secret et à la méconnaissance. J'en veux pour preuves Adieu Philippine de Jacques Rozier et Une chambre en ville de Jacques Demy dont les sorties et reprises ont chaque fois été des flops, malgré les critiques dithyrambiques qui les ont toujours accompagnés. Eo est le nom d'un âne, un âne polonais comme le film, et c'est une merveille réalisée par un jeune cinéaste de 85 ans à qui l'on doit déjà et entre autres Le départ (1967), Haut les mains (Ręce do góry, 1968), Deep End (1970), Travail au noir (Moonlighting, 1982), Essential Killing (2010), des films hors du commun... Un site est consacré à ce Prix du Jury cannois, mais je ne sais pas par quel bout le prendre. Tout y est extraordinaire : les images (Michał Dymek), le son et la musique (le compositeur contemporain Paweł Mykietyn a reçu un Disque d'or à Cannes et le prix du cinéma européen 2022), les décors (Mirosław Koncewicz), le montage (Agnieszka Glińska), etc. Le scénario est de Skolimowski et son épouse, Ewa Piaskowska, qui a produit ses quatre derniers longs métrages et co-écrit trois d'entre eux. La seule faille est la scène avec Isabelle Huppert, exogène, absolument pas nécessaire, probablement ajoutée en toute camaraderie ou pour des raisons contractuelles de coproduction. Le cinéma existe encore. Ce n'est pas un hasard si Eo s'inspire de Au hasard Balthazar, et il y a d'ailleurs d'autres clins d'œil discrets au cinématographe de Robert Bresson.
Pas question de divulgacher (spoiler en anglais) quoi que ce soit. Je m'en empêche toujours même si je reproduis de temps en temps les bandes-annonces. Plus haut, je liste les éléments de la recette par manque de mots pour décrire l'expérience sensorielle vécue lors de la projection. Il y a d'ailleurs très peu de mots pendant l'heure et demie que dure Eo. Il convoque nos sens au delà du descriptible. Beauté, intensité, émotion. Il nous renvoie à notre propre existence humaine. Il ne me reste plus qu'à le revoir pour comprendre comment je fonctionne devant une telle évidence. Celles et ceux qui ne l'ont pas encore vu ont une sacrée chance. Les autres sont comme moi, ils y retourneront forcément un de ces jours ou l'une de ces nuits.