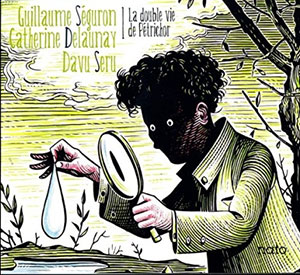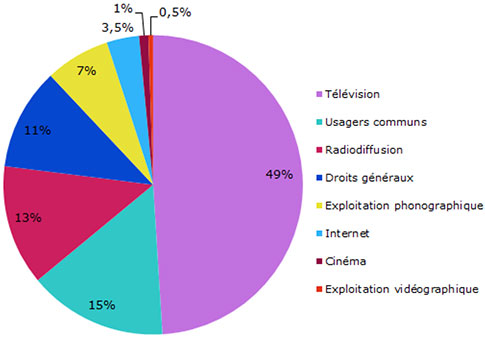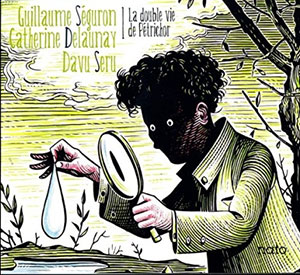
Clair et net, le jeu de mots est facile, mais la clarinette recèle des qualités expressives que le saxophone avait escamotées pendant un demi-siècle de nouveau jazz. Si
Sidney Bechet et
Benny Goodman lui avaient donné ses lettres de noblesse swing, l'instrument restait un peu timide jusqu'à ce que des musiciens européens se démarquent de la puissance américaine pour revendiquer leur culture et la diversité de leurs terroirs. Le métal, brillant et explosif, est aux États-Unis ce que le bois, tendre et délicat, est à l'Europe. L'Histoire n'est pas la même. L'esclavage engendra des formes radicales, là où les Lumières jouaient de leur passé encyclopédique. Dans les musiques populaires, les saxophones, la batterie, la guitare électrique conquirent le vieux continent au détriment des bois et des cordes. Dans le jazz les grands violonistes se nommaient Stéphane Grappelly, Jean-Luc Ponty. Venus du classique, quantité de violoncellistes émergèrent dans notre pays. Quant à la clarinette, nombreux doivent beaucoup à Michel Portal, la clarinette basse trouvant longtemps plus de grâce aux oreilles des jeunes musiciens que sa sœur cadette. En lisant la
liste des clarinettistes jazz sur Wikipédia, y figurent Denis Colin et Louis Sclavis, mais en sont absents Jacques DiDonato, Sylvain Kassap, Étienne Brunet, Nano Peylet, François Cotinaud, Laurent Dehors, Sylvain Rifflet, Joris Rühl, Antonin-Tri Hoang, Jean-Brice Goddet, Jean Dousteyssier, Julien Pontvianne, Yom, et quantité d'autres qui auront la gentillesse de ne pas m'en vouloir
en me ravivant la mémoire ou en se signalant. On peut trouver sur Wikipédia une autre liste aussi incomplète, même si elle
répertorie uniquement les Français...
En trio avec le contrebassiste nîmois
Guillaume Séguron et le batteur minesottien
Davu Seru, la clarinettiste bretonne
Catherine Delaunay sort chez nato un album rafraîchissant intitulé
La double vie de Pétrichor. Le premier morceau me rappelle Le Peuple Étincelle, le groupe de bal du saxophoniste François Corneloup (et ce n'est pas parce que j'ai toujours préféré les bois et les cordes aux saxos, la percussion à la batterie que je vais devenir sectaire !), probablement pour la référence aux musiques traditionnelles et à la danse, nos jazz et tango à nous. La rencontre des trois musiciens aux origines différentes construit une conversation homogène où chacun se retrouve dans cet espéranto que l'on appelle musique. Le jazz se mâtine des traditions d'improvisation européennes et des folklores de l'hexagone. Catherine Delaunay joue de temps en temps du
re-recording en attrapant un cor de basset, un accordéon ou une scie musicale, nous transportant sur le terrain humide de Pétrichor. Car comme souvent dans les productions du label nato le livret permet à la bande dessinée d'interpréter les notes qui s'échappent, se croisent et fusionnent. L'illustrateur
Matthias Lehmann dessine ainsi un conte elliptique qui sent bon l'humus, euh pardon le
pétrichor, en s'inspirant de ce qu'il entend. Avec cette petite bande nous sautons à pieds joints dans les flaques, nous réfléchissons dans un miroir multifaces, allons boire à la source en retrouvant les origines de la musique américaine, celles des peuples "natifs" ou esclavagisés, et revendiquons nos terroirs, gage de la mixité, du partage et de l'échange.
→ Guillaume Séguron, Catherine Delaunay, Davu Seru,
La double vie de Pétrichor, nato, dist. L'autre distribution
P.S. : après Jacques Oger, c'est au tour de Franpi de me susurrer "Que des français, ou des européens ? Parce que sinon, Joachim Badenhorst, Christoph Erb, Matthieu Donarier, Julien Eil, Thomas Savy, Christophe Rocher, Olivier Thémines, István Grencsó, Mihály Bórbely,Hugues Mayot, Lars Greve, Joris Roelofs, Jean-Marc Foltz, Matteo Pastorino, Ziv Taubenfeld, Michael Jaeger, etc." Et encore Jacques ajoute Rudi Mahall et Jurg Frey... Gary May a ajouté son compatriote, Alex Ward !