vendredi 16 juillet 2010
Nuits blanches
Par Jean-Jacques Birgé,
vendredi 16 juillet 2010 à 01:26 :: Cinéma & DVD
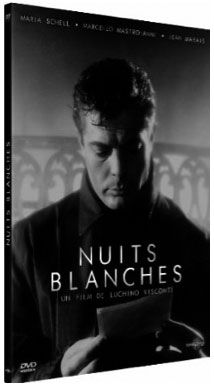
Nuits blanches a la brutalité du rêve : rien n'est plus cruel que le réveil. En 1957 Lucchino Visconti abandonne le néoréalisme qui a fait son style et son succès pour un néoromantisme où le réalisme poétique sert l'intemporalité du conte. À l'époque la critique ne lui pardonnera pas. La beauté des images en noir et blanc colle avec les contradictions intérieures des protagonistes ; le flou du brouillard qui les grise, réalisé avec des tulles immenses au lieu d'effets de fumée, la neige qui tombe sur un coup de baguette magique font ressortir les sentiments puissants qui nous enchaînent et nous entraînent. Visconti porte le théâtre essentiel à l'écran par une maîtrise absolue de l'art cinématographique. Il construit à Cinecitta le décor de Livourne, la petite Venise, pour que l'intrigue soit non seulement de toujours, mais aussi de nulle part. Dans l'un des bonus qui accompagne la superbe copie remasterisée (Ed. Carlotta), le chef costumier Piero Tosi évoque le réalisateur avec une élégance et une maîtrise dont on devine la complicité avec le maître. Le film est une leçon de vie et une leçon de cinéma. La solitude des personnages montre à quel point il est difficile de partager le même rêve. Marcello Mastroiani en garçon pudique hors de son temps, Maria Schell en jeune fille à peine sortie des jupons de sa grand-mère, Jean Marais en beau ténébreux étonnamment froid et absent, Clara Calamai la prostituée dont la tendresse et l'injustice font partie du métier, vivent dans des mondes parallèles.
En revoyant le film, j'ai pensé au tragique Parapluies de Cherbourg de Jacques Demy, et puis j'ai eu très envie de revoir Les quatre nuits d'un rêveur, autre adaptation du même roman de Dostoïevski par Robert Bresson en 1971. Plus récemment James Gray rendit explicitement hommage au romancier russe et au réalisateur italien en filmant Two Lovers. La version de Bresson est, comme chez Visconti, en porte-à-faux par rapport à ses précédents films, plus terre à terre dans cet impossible qui le caractérise. Ses effets de modernité sont encore plus caricaturaux que le rock 'n roll de Nuits blanches, mais ils en retirent une éternité blessante qui nous renvoie encore à notre solitude tout en étant plus que jamais de notre temps. Sa direction clinique renforce l'aspect obsessionnel. Les quatre nuits d'un rêveur est, je crois, bloqué par des problèmes de droits, mais il serait passionnant de le comparer aux Nuits blanches comme le fit Criterion en publiant ensemble Les bas fonds porté à l'écran par Jean Renoir et Akira Kurosawa d'après un roman cette fois de Maxime Gorki...
Au cinéma, le pouvoir de l'imagination confère aux films un ailleurs qui nous est proche et que nous ne pouvons partager avec personne. Un célèbre carton dans Nosferatu de Murnau effleure cet inconscient qui se raccroche au réel en s'appuyant subrepticement sur le phénomène d'identification, reconnaissance de ce que nous avons déjà vécu, fut-ce dans un rêve : "De l'autre côté du pont, les fantômes vinrent à sa rencontre."
