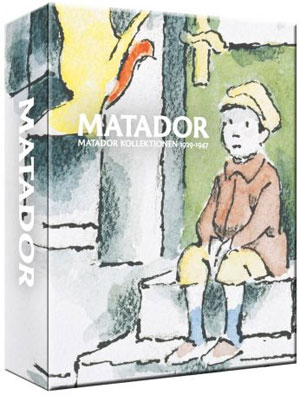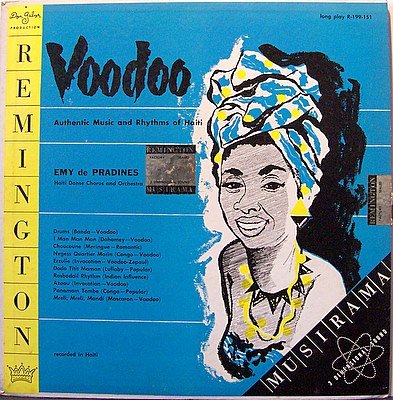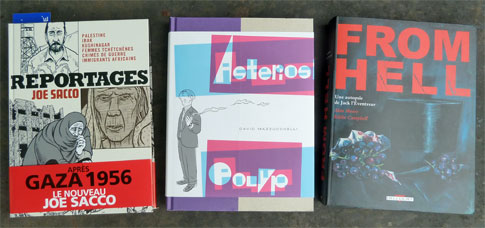vendredi 30 décembre 2011
2. Long Island
Par Jean-Jacques Birgé,
vendredi 30 décembre 2011 à 08:25 :: Roman-feuilleton

Gargam s'était moqué de nous en évoquant "son château". Il est pourtant agréable de se promener sur la plage après le long voyage et malgré la grisaille. Agnès est frileuse. Nous jouons au scrabble en attendant qu'il fasse meilleur. Au déjeuner nous entrons de plein-pied dans les coutumes locales, hot-dogs au barbecue, et l'après-midi nous partons visiter Port Jefferson, un petit village au bord de la mer d'où nous rapportons des banana barges qui fondent en route. J'ai toujours adoré les glaces. Petits, nous allions à l'Igloo, rue de Sèvres, où, avec, on nous servait une verre d'eau glacée. Je ne pouvais m'empêcher de ne prendre que des boules au chocolat. En rentrant nous tondons la pelouse du château et nous nous laissons hypnotiser par les Three Stooges à la télévision. La publicité coupe sans cesse le programme. Quant à la pelouse, je n'ai jamais compris cette manie de la coiffure en brosse, préférant la liberté des herbes folles. C'est comme la cravate, je me suis juré de ne plus jamais me serrer le quiqui avec cette corde qui me fait penser à une laisse patronale. (feu d'artifice débordant jusqu'au paragraphe suivant en se transformant comme si les sons s'allongeaient dans le ciel) Après un cheese-burger pour dîner nous allons voir le feu d'artifice sur la plage. C'est comme souffler sur les bougies de l'immense gâteau qui nous est offert pour inaugurer notre périple. Des sparkling sticks à la taille du pays. Tout est énorme, les voitures, les plats, les gens.
Ma sœur a commencé à écrire son journal. Je me suis chargé de préparer les bagages pour repartir à New York vers midi. Nous les laissons à la consigne des Greyhound Buses et montons en haut de l'Empire State Building, cent deux étages, trois cent quatre vingt un mètres, le plus haut immeuble du monde. La tour Eiffel est riquiqui à côté ! La vue est impressionnante. Nous admirons la ville depuis les quatre côtés. Comme j'ai soif, je cherche une boîte de conserve au distributeur qui est tout en haut. Curieux, j'opte pour une boisson infâme appelée root beer, un mélange de racines et de plantes au goût synthétique. "Berk !" fait Agnès en trempant ses lèvres dans l'immonde breuvage. En redescendant nous sommes stupéfaits par la queue des touristes qui s'est encore allongée en bas du gratte-ciel.
Nous commençons à reprendre pied après le décalage horaire et nous sommes seuls, livrés à nous-mêmes, avec en poche quelques travellers cheques et nos abonnements de cars Greyhounds, mais pas suffisamment d'argent pour nous offrir un hôtel. Il va donc falloir nous débrouiller. L'astuce est de voyager la nuit pour ne pas avoir à chercher quelqu'un pour nous héberger. Si nous comptons sur des rencontres, nous avons quelques points de chute, à Cincinnati dans une famille où Agnès est restée lors d'un séjour scolaire, à El Paso chez un couple rencontré en vacances au Maroc, chez les Birge chez qui j'ai passé l'été 1965, et puis l'un des patrons de mon père habite Boston, c'est tout.
En 1964, mes parents reçoivent un coup de téléphone de deux Américains de passage à Paris, à la recherche de leurs origines en Europe. Henry et Sylvia Birge, prononcé Beurdge, qui arrivent de Stockholm, les invitent à boire un verre à l'Hôtel Intercontinental. Dans la conversation ils suggèrent de m'envoyer chez eux perfectionner mon anglais. Mon père saute sur l'occasion et je passai ainsi suivant dans le Connecticut. Ils me racontèrent qu'un Birge fut conducteur de convoi avec Buffalo Bill et prétendaient descendre des cent pèlerins arrivés à Plymouth sur le Mayflower en 1620. Ils m'emmenèrent ainsi sur les traces de ceux qui furent les premiers conquérants de ce qui deviendra les États Unis, cultivant une paranoïa que je trouvais surréaliste. Malgré la psycho-rigidité de Henry nous avons prévu d'aller leur rendre visite sur la route du retour dans deux mois. Nous ne sommes évidemment pas du tout de la même famille. Ils viennent de Scandinavie tandis que notre patronyme est plus ou moins alsacien. Plus ou moins ? La communauté juive était extrêmement nombreuse en Alsace avant la seconde guerre mondiale. En 1870, lorsque l'Allemagne annexe l'Alsace et la Lorraine, mes ancêtres transforment Berger en Birgé, avec un accent aigu bien français sur le é pour mettre le point sur le i que nous ne sommes pas allemands. Le berceau de la famille est Marmoutier, lointain cousinage, du côté maternel, avec Albert Kahn, banquier ruiné en 1929 et fondateur des archives de la planète, et Dassault, nom de résistant de Marcel Bloch. Ma mère est une Bloch, mais il faut toujours une branche fauchée à tous les arbres généalogiques ! C'est pareil du côté paternel puisque mon arrière-arrière-grand-père aurait effectué son service militaire de six ans à une époque où le recrutement se faisait par engagement et tirage au sort, mais où les riches se faisaient remplacer moyennant finances. Je profitai de l'aubaine et passai deux mois formidables à East Hartland et sur le yacht de mes hôtes au large des côtes de la Nouvelle Angleterre.
Ce voyage n'est donc pas une première, ni pour ma sœur, ni pour moi. Nous sommes tous les deux assez débrouillards, ma sœur est moins timide que moi, mais je viens de vivre deux mois dans la rue à battre le pavé quand il en reste, puisque à maints endroits ils ont été remplacés par la plage.
Précédemment :
-2. Introduction à mon second roman
-1. Tour, détour, deux enfants
0. La révolution
1. J'ai 15 ans