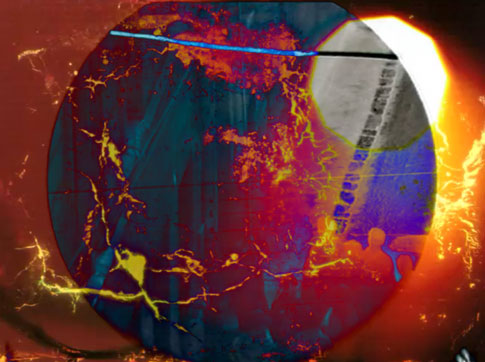 Ouverture encyclopédique
Ouverture encyclopédique
À six ans je lus le Petit Larousse illustré de la lettre A à la lettre Z. Plus tard, je dévorai le Grand Atlas Mondial du Reader's Digest, explorant chaque coin du monde par les cartes, le relief, les statistiques, les grandes découvertes ou les photographies sur papier glacé qui fermaient l'ouvrage. Aujourd'hui encore je n'irais pas me coucher sans avoir appris quelque chose de ma journée et à mon tour j'ai choisi de transmettre ce qui m'avait été légué par celles et ceux que j'ai eu la chance de rencontrer. Le blog que je tiens quotidiennement depuis sept ans en est l'une des manifestations.
Diplômé de l'Idhec, l'Institut des Hautes Études Cinématographiques devenu la FEMIS, je composais la musique de mes films. Les camarades me réclamant des partitions sonores pour les leurs, je devins sans m'en apercevoir compositeur de musique, abandonnant pour un temps la réalisation. Je ne concevrai plus alors mon rôle de compositeur que dans la confrontation aux autres arts. Le cinéma et la musique étant déjà des formes d'expression qui se pratiquent généralement à plusieurs, j'en parle souvent comme de sports collectifs, avec l’immense avantage de pouvoir y ignorer la compétition au profit du partage !
Méfiant vis à vis des spécialistes qui ne voient le monde que sous un angle unique et étroit, je me penserai désormais comme un généraliste, quitte à développer ici et là quelques spécialités, de préférence inédites, de manière à ne pas souffrir la comparaison avec les virtuoses qui travaillent huit heures par jour leur instrument...
Lors des conférences que je donne sur le rapport du son aux images, j’insiste toujours sur la nécessité de s’inspirer d’autres arts que le nôtre. Je crains par dessus tout la consanguinité et l’enfermement communautaire qui empêchent la rencontre, fruit de tous les possibles.
Un drame musical instantané
On cherchera vainement dans l’Histoire de la musique l’origine de la mienne et celle du groupe Un Drame Musical Instantané, fondé avec Francis Gorgé et Bernard Vitet en 1976, car toutes les influences y sont présentes. D’y négliger aucun style, aucun continent, aucune démarche, c’est n’en privilégier aucun, nous laissant libres d’emprunter toutes les formes dès lors qu’elles servent notre propos. Nous l’appellerons d’ailleurs « musique à propos », terme plus juste que celui d’instantané qui ne se référait qu’à l’improvisation que nous opposions à la composition préalable et pratiquions exclusivement aux débuts de notre rencontre. Dès 1980 nous commençâmes à écrire, structurant en amont notre langage, pour ne garder de la composition instantanée que l’interprétation ouverte, variations inattendues au gré de notre humeur ou des événements politiques qui nous occupent.
Je cherchais naïvement à me renouveler sans cesse et mes amis de commenter « c’est bien toi ! » à mon grand dam. Mes racines plongent naturellement dans ma formation de cinéaste, ma musique obéissant à des lois cinématographiques plus qu’aux règles du contrepoint et de l’harmonie. Le montage (entendre le montage cut et les ellipses qu’il génère, à savoir que ce que l’on coupe est plus important que ce que l’on garde !), les effets de perspective (gros plans, plans d’ensemble, etc.), le rôle des ambiances et des bruits dans la partition sonore, la narration (commune aux poèmes symphoniques), l’utilisation nécessaire de certaines musiques culturellement connotées, fondent ma méthode de composition.
Autodidacte en musique, j’inventai des moyens techniques d’arriver à mes fins en contournant mes incompétences. Lorsque cela ne suffit pas, je fais appel à des camarades capables de combler mes désirs, quitte à cosigner avec eux ou avec elles. Pendant les trente ans qu’a duré le Drame, nous nous suffisions à nous-mêmes, très complémentaires, progressant en toute indépendance. Mais à ne rien demander à personne, aucun musicien ne nous demandait plus rien. Nous étions maîtres depuis toujours de nos moyens de production puisque j’avais fondé les Disques GRRR en 1975 et possédais mon propre studio, nous avions monté un grand orchestre et étions producteurs de tous nos spectacles. Je commençai à me sentir étouffé par cette indépendance qui m’avait pourtant toujours permis de vivre de mon art. En travaillant sous mon nom propre, je me donne aujourd’hui l’occasion de multiplier les rencontres avec des artistes venus d’horizons les plus divers, y compris des musiciens !
Pour être de partout il faut être de quelque part
Lorsque je rencontre un individu, professionnellement ou dans la vie quotidienne, j’aime connaître ses spécialités. Vous remarquerez le pluriel. Qu’elles soient gastronomiques ou artistiques, je cherche leur personnalité, souvent fortement orientée par leurs origines géographiques, sociales, professionnelles, etc. Je désespère d’entendre des œuvres qui se ressemblent, sans référence à leurs terroirs. Le formatage induit par le marketing ou l’impérialisme culturel américain réduit dramatiquement le paysage musical.
Les prérogatives de classe sont aussi néfastes. J’en veux pour preuve la bataille stérile qui fit rage récemment à propos de la nomination à la Villa Médicis de deux compositeurs, l’une venue de la chanson française, l’autre du jazz. La recherche n’est pas l’apanage de la musique dite contemporaine. Au XXe siècle, à partir de l’École de Darmstadt, les compositeurs « savants », pour la plupart, se coupèrent des musiques populaires, s’enfermant dans un sérail consanguin qui ne pouvait générer que des enfants idiots. Les dernières révolutions, technologiques comme souvent dans l’Histoire des arts, proviennent du marché grand public et de sa lutherie : guitare électrique, synthétiseur, informatique domestique, etc.
D’un autre côté, la world music, par un impérialisme plus paternaliste que malveillant, perdit l’essence des sources empruntées. Le mélange ne peut être prolifique que s’il s’agit de véritables rencontres et non d’une absorption colonialiste sans comprendre les cultures invitées. Les démarches sont parfois louables, je pense aux espagnolades des impressionnistes ou aux oiseaux de Messiaen, mais peuvent paraître ridicules ou absurdes en regard des originaux.
Solidarité et persévérance
La musique était déjà un mode d’expression universel ne nécessitant aucune traduction. Elle s’importe, s’exporte, ouverte à toutes les rencontres. Jamais, dans l’Histoire des hommes, cela n’aura été aussi facile. Internet rend instantanée la communication. Les moyens de locomotion permettent de filer à l’autre bout de la planète en quelques heures. L’anglais est devenu la langue universelle (même si cela ne va pas dans le sens de ma démonstration !). Et pourtant jamais la création n’aura été aussi handicapée. La mainmise des multinationales sur l’industrie du disque, la politique réactionnaire des sociétés d’auteurs face à la circulation des œuvres, les replis communautaires, les querelles de chapelles, la frilosité des programmateurs - hormis quelques uns comme Les 38e qui proposent toujours des spectacles qui sortent de l’ordinaire

- empêchent les voix originales et indépendantes de se faire entendre.
Le pire des risques est de n’en prendre aucun. Sans rencontre, le goût n’y est pas. Il faut savoir épicer son travail avec ceux des autres, donner, recevoir, partager. Qu’y a-t-il d’autre qui vaille de vivre ?
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Ce texte fait partie du livre
Composer le monde qui vient de paraître autour des 22 éditions du Festival des 38e Rugissants (
article d'hier). Écrit il y a trois ans, il répondait à la demande de "réfléchir aux croisements des cultures, des disciplines, des lieux..." Depuis, le festival a fusionné avec le Grenoble Jazz Festival pour devenir
Les Détours de Babel. Trois créations ont marqué mon passage aux 38e :
Zappeurs-Pompiers 2 en 1989,
Sarajevo Suite en 1994,
Sarajevo, suite et fin en 2003. L'illustration est issue de la couverture interactive de
USA 1968 deux enfants, roman augmenté publié pour iPad par
Les inéditeurs.





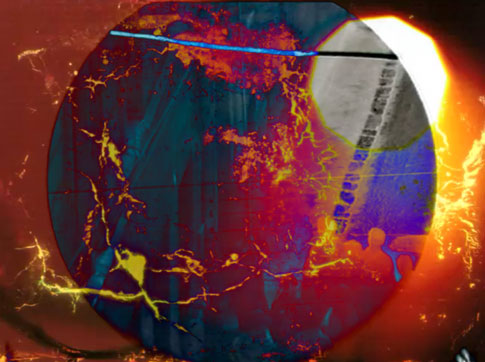
 - empêchent les voix originales et indépendantes de se faire entendre.
- empêchent les voix originales et indépendantes de se faire entendre.
















